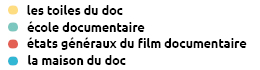2016
2016  Docmonde
Docmonde Docmonde
La proposition de films issus du réseau international de documentaristes que nous cherchons à bâtir s’intitule désormais DocMonde ! Mais changement d’intitulé ne signifie pas changement de contenu. Pour cette édition, ce sont onze films que nous avons choisi de vous faire découvrir, issus des quatre zones géographiques où se sont déroulées des résidences d’écriture et des rencontres de coproductions.
Pour démarrer : quatre premiers films d’Afrique de l’Ouest, deux le vendredi matin, deux le vendredi soir. Pour qualifier ces films, on pourrait reprendre les mots de Camus, qui les définissent assez bien, me semble-t-il : « ne pas confondre tragédie et désespoir ». Ces quatre réalisatrices et réalisateurs vivent des réalités dures. Dans La Colère dans le vent, Amina Weira, frêle silhouette, arpente sa ville d’Arlit, au Nord Niger, de maison en maison, avec son père comme guide. Elle révèle la dimension quotidienne de la contamination nucléaire. D’emblée, l’enjeu de ce film est posé. La détermination de ce petit bout de femme semble tellement tenir du miracle que l’on ne lâche pas ce film qui documente une réalité à même les gens, une réalité de terrain jamais vue. Les images de vent de sable en fin de film nous restent en mémoire, tant ces nuages sont désormais chargés de poussière de mort et donnent au film toute sa dimension poétique.
Ousmane Samassekou, lui, est étudiant à l’université de Bamako, à l’endroit même où il pose sa caméra. Il filme lui aussi « son monde » dans Les Héritiers de la colline, nous entraînant dans une édifiante plongée au cœur de l’élection du syndicat étudiant de l’université de Bamako et des pratiques manipulatrices et mafieuses qui l’accompagnent. En immersion pendant des semaines, il nous donne à comprendre que c’est là le laboratoire des règles démocratiques ou totalitaires du futur Mali. Même si le constat fait froid dans le dos, il s’agit d’un cinéma qui donne à voir pour comprendre et changer l’inacceptable. Le film d’Ousmane Samassekou est caractéristique de la fonction politique de la création documentaire indépendante en Afrique aujourd’hui, de sa capacité à organiser des récits structurants du quotidien et de dessiner des fresques sociales inoubliables.
C’est aussi le cas du film d’Eddy Munyaneza. On y franchit un degré de plus dans « le tragique de l’histoire immédiate ». Journaliste obligé de fuir son pays, le Burundi, sans nouvelles de sa famille, il a réalisé Le Troisième Vide depuis le Master de Saint-Louis, au Sénégal, où il vient de passer huit mois. Ce film est une sorte de témoignage pour l’histoire. C’est aussi ce qui en fait la force. Le journal d’une tragédie personnelle et la manifestation inlassable de l’espoir.
Comme Amina Weira, Aïcha Macky est nigérienne et également issue de la promotion 2013 du Master de Saint–Louis, au Sénégal. Son film L’Arbre sans fruit, comme les trois précédents films africains, est d’abord le récit de quelque chose qui lui arrive : Aïcha, mariée, n’a pas d’enfant, et au regard de la société nigérienne, les femmes sont responsables de l’infertilité du couple. À l’image de sa superbe mise en image et de ses personnages, ce film est en tout point lumineux. Il ne se contente pas de documenter un fait de société : il en déborde le cadre pour nous entraîner dans des mouvements de complicité, de solidarité et d’intimité féminine où la dimension poétique l’emporte sur toute autre considération. Un film particulièrement réussi.
Vendredi après-midi, on change de géographie et de cinéma avec la sélection de films passés par les résidences et le Master de Lussas. Démarrage par un film pictural au récit ténu de Marie Bottois. Dans Slow-Ahead, c’est le donner à voir autrement qui s’impose : sens des lignes et des formes dans l’espace, blocs de couleurs, masse en mouvement des bateaux-machines, l’obsession des formes et des couleurs dessine un paysage intérieur que l’on a plaisir à parcourir.
Le film d’Anaëlle Godard, Au jour le jour, à la nuit la nuit, est un retour sur un territoire abondamment filmé : celui de La Borde. Sa singularité tient probablement au fait qu’elle filme ce haut lieu de la psychiatrie institutionnelle comme on filme sa communauté familiale pour la reconstituer, la rassembler par les images, en essayant de n’oublier personne – ni sa mère qui y travaille, ni le père des lieux, Jean Oury, ni les patients, ni les soignants – en filmant les individus comme le groupe et en n’oubliant pas – c’est l’une des grandes qualités du film – de filmer le temps dans le vent qui agite les arbres.
Lettre à ma mère – Les Fantômes de Marguerite va bien au-delà d’une histoire personnelle. C’est l’un des rares documentaires sur l’addiction à l’alcool raconté comme un journal à la première personne. Par la récurrence de certaines images, il nous plonge dans « l’état de dépendance » et la recherche de bouées de sauvetage dans les figures admirées de Marguerite Duras et Gilles Deleuze. Autant de pensées qui témoignent des réponses que l’on peut apporter à cette maladie qu’est l’alcoolisme. Le film, par son existence même, témoigne de la distance prise par le réalisateur et dessine en lui-même l’issue possible du cauchemar.
Pour la journée de samedi, deux temps : le matin sera consacré à deux films de Madagascar issus des résidences d’écritures et rencontres de coproductions de Tamatave. Ces films sont à eux seuls des miracles, tant les conditions de vie et de réalisation sont dures aujourd’hui à Madagascar. Longue vie aux morts est le premier film de Maminihaina Jean-Aimé Rakotonirina et s’il est si étonnamment accompli, c’est dû en grande partie à la bonne distance de filmage des protagonistes. Le réalisateur filme avec un immense respect ce qu’il reste des rituels et croyance traditionnels, comme si filmer voulait dire célébrer et perpétuer ! Ce qui pourrait être un regard ethnographique ou à l’opposé exotique échappe ainsi aux deux approches. Le réalisateur filme et sacralise, et gageons que vous n’êtes pas prêts d’oublier le long plan nous donnant lentement à découvrir la gardienne du temple s’avançant depuis le bout de la rue.
Njaka Kely est la troisième réalisation de Michaël Andrianaly. Il fait lui-même l’image de ses films. Il s’inscrit dans la tradition du cinéma direct : la question centrale est de saisir sur la durée la transformation des situations et l’évolution des personnes. Le réalisateur s’immerge dans une petite communauté de cyclo-pousse, tenue de main de maître par une Madre Padrone : c’est ce qui s’appelle être plongé dans une réalité peu documentée. Le film nous instruit sur la vie des milliers de cyclo-pousse qui travaillent à Tamatave aujourd’hui et sur la façon dont s’organise ce petit business de la pauvreté, auquel seul le travail obsessionnel d’un cinéaste comme Michaël Andrianaly peut nous donner accès.
L’après-midi du samedi est consacrée à deux premiers films de réalisatrices russes. Après une résidence en Sibérie, elles ont présenté leurs projets aux rencontres de coproduction d’Erevan, en Arménie, en 2014. Anna Moiseenko sort tout droit de l’école de cinéma direct de Marina Razbeshkina de Moscou. Dans ce film, elle s’attaque à la question universelle de l’immigration via les exilés tadjik de Moscou. Elle a filmé seule pendant des mois Abdoul, musicien tadjik condamné à faire des petits boulots pour survivre à Moscou. La Ballade d’Abdoul prend toute son ampleur dans de longues séquences où l’on accède à l’intimité d’Abdoul. Au même titre qu’un chanteur folk, il raconte par ses complaintes les galères et petites joies de son quotidien. C’est cette dimension de ballade qui donne au film une tonalité proche de la fable. Les allers-retours entre ce qui est raconté par les improvisations chantées et les séquences de la vie réelle sont la singularité même de ce premier film.
Maria Murashova boucle cette programmation avec Les Ramasseurs d’herbes marines. Elle vient de Saint-Pétersbourg et a choisi de filmer en Sibérie et nous plonge littéralement dans le monde aquatique des ramasseurs d’algues. C’est aussi un film sur l’espace et une communauté d’hommes aux prises avec eux-mêmes et avec les caprices de la nature. Comme Anna Moiseenko, Maria Murashova tente de saisir quelque chose qui va bien au-delà de la simple fonction de documenter. Il y a dans ce film un projet de cinéma : celui de filmer une mélancolie propre à ce lieu du bout du monde et à ces hommes relégués.
Jean-Marie Barbe
En présence des réalisateurs et/ou des producteurs.
Débats animés par Jean-Marie Barbe.