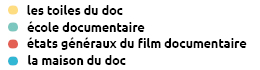2015
2015  Route du doc : Espagne
Route du doc : Espagne Route du doc : Espagne
Entre deux mondes
De l’intime à l’Histoire, de la narration personnelle au portrait du monde qui les entoure, les films des cinéastes espagnols explorent la complexité du territoire et la richesse de ceux qui le peuplent, sans pour autant cesser de regarder au-delà des frontières, en cherchant des reflets et des similitudes entre le local et le forain, entre soi et l’autre, entre le passé et le présent, les vivants et les morts, tout ce qui crée un écart dans lequel peut se glisser le cinéma.
Andrés Duque, vénézuélien établi en Espagne, vit dans le territoire éthéré de l’exilé et nous livre un journal intime comme en suspension (Ensayo final para utopía), dont l’ordre des pages semble seulement répondre à la sensibilité de ses souvenirs, où grâce et gravité s’accordent dans des moments d’apnée visuelle et sonore. D’une autre génération, Eloy Domínguez Serén réfléchit aussi au fil des jours de son journal filmé à cette dualité : l’abandon de sa Galice natale pour trouver n’importe quel travail en Suède, autant dire aux antipodes (Ingen Ko På Isen). Une âme contrainte à l’errance, oscillant entre la condamnation à répéter un passé ancestral de migrant et la vigueur de celui qui fait face à de nouveaux défis. Un voyage semblable à celui de ces acteurs espagnols qui dans les années trente ont laissé derrière eux leur pays pour répondre aux chants prometteurs des sirènes de La Mecque du cinéma, comme nous le fait revivre Óscar Pérez (Hollywood Talkies).
Entre deux rives navigue également (Emak Bakia Baita) le dialogue entre le « voyage » de Man Ray au Pays basque, au début d’un autre siècle, et l’enquête sinueuse d’Oskar Alegría : entre l’anarchie et le hasard du premier et l’évocation poétique et ludique du second qui tente de saisir ce qui ne serait déjà plus qu’une poussière dans le vent.
Retracer
Retracer un chemin pour trouver des réponses égarées et se livrer à un exercice d’introspection qui mène aux nœuds originels, pour lever les entraves du passé et libérer quelques passages dans le présent. C’est un sentier escarpé mais parfois salvateur que doit emprunter le documentaire tout autant que la société espagnole, dont les profondes fractures issues du passé restent encore ouvertes.
Deux réalisatrices explorent les failles familiales de leur relation filiale. Pilar Monsell (África 815) accueille toute l’ambiguïté de l’histoire amoureuse complexe et douloureuse de son père, en prise avec un passé colonial encombrant. Dans le huis clos de leur relation, elle accueille ce récit troublé dans une écoute « réfléchissante », comme un geste d’apaisement et de reconnaissance mutuelle, au regard de leur relation infructueuse. Francina Verdés (La casa del meu pare) sillonne la région de Navarre pour interroger ceux qui, comme elle, subissent le poids de la tradition les excluant de tout héritage au profit du fils aîné. « Comment intègre-t-on ce passé dans le présent ? » dit-elle pour formuler un doute plus intime. Ses rencontres la mèneront à pointer les contradictions et assumer les séparations, aussi douloureuses soient-elles.
En l’absence de témoins et d’images, entre le mythe et l’Histoire, il devient plus difficile de retrouver un chemin vers le passé. Carolina Astudillo Muñoz (El gran vuelo) se saisit de cette absence de traces pour reconstruire la trajectoire de la vie d’une inconnue, militante clandestine dans les premières années de la dictature franquiste. Par un montage minutieux d’archives amateur, la réalisatrice réussit à incarner les aspects plus occultes et intimes de l’engagement politique de cette femme.
Jorge Tur Moltó (Dime quién era Sanchicorrota) s’attelle lui aussi à réveiller l’histoire d’un légendaire « Robin du désert » de Navarre, prétexte à des rencontres avec les autochtones, chacun y allant de sa version de l’histoire. À travers les récits recueillis dans son exploration de la région, de ses traditions et de son paysage, les époques s’entrechoquent et il exhume d’autres strates de l’Histoire encore bien vivante. Et à nouveau, Francina Verdés (Cosas raras que pasaban antes), dans un court métrage prémonitoire de La casa del meu pare, prend la route pour accompagner un vétéran de la guerre civile. Retracer un si long chemin conduit parfois à se perdre. L’oubli et les disparitions auxquelles se heurte le vieil homme nous rappellent les amnésies de l’Histoire récente de l’Espagne. À quel point il est parfois difficile, voire impossible, de saisir la mémoire historique quand elle est déjà si lointaine.
Dense passé, lent présent.
Ce passé, qui en Espagne est si dense, se transforme lentement et avec inertie. Tenter de dévoiler ou d’inverser ce lourd héritage, par un geste artistique et cinématographique… C’est l’un des défis plus suggestifs de la création contemporaine.
Renverser le pouvoir, c’est littéralement la proposition des deux artistes Jorge Galindo et Santiago Sierra (Los encargados), où l’on voit défiler dans la capitale en miroir, au son du chant des anarchistes, les figures des gouvernants de la nation : « les responsables ». Inversion encore, avec le collectif Los Hijos (enero, 2012 (o la apoteosis de Isabel la Católica)) qui joue de la confrontation entre son et image, pour exposer le paradoxe entre le passé monumental de Madrid, son commentaire archaïco-touristique, et le présent de ses citoyens comme pétrifiés par l’incertitude de leur condition. Tout autrement mais avec un même désir dialectique, Andreas Fontana (Pedro M, 1981) revisite le passé en réécrivant par-delà les images historiques connues de tous en Espagne : celles du coup d'État manqué de 1981. Par un travail d’investigation fictionnelle, le réalisateur nous livre des témoignages qui brouillent toute interprétation et creuse en deçà des faits pour imaginer des ressorts plus intimes parfois insoupçonnés.
C’est par une démarche documentaire plus classique qu’Alessandro Pugno (All'ombra della croce) réussit à pénétrer un lieu tabou, le tristement connu Valle de los Caídos (« Vallée de ceux qui sont tombés »), pour tenter de découvrir des lignes souterraines du passé. Son observation distante du fonctionnement de l’institution religieuse enracinée dans la dictature franquiste fait affleurer derrière la façade du présent d’autres visages occultes du passé et nous fait approcher ce qui s’enseigne et se transmet ici.
Changement radical d’univers, mais avec une approche formelle et un lieu soustrait au regard similaires, les jeunes cinéastes Carmen Esplandiu et Emilia Valentin (La senyora que feia senyors) nous entraînent dans le quotidien d’une maison close qui porte bien son nom. L’activité du lieu ne filtre qu’à travers la gestion familiale de la maîtresse des lieux, présente à chaque plan du film. Du hors champ nous parviennent des bribes d’une tristesse du monde et de la violence sociale d’un travail contraint, concentrées dans ce lieu qui semble d’une autre époque et pourtant immuable.
Le même sentiment ambigu se dégage de A Conserveira de David Batlle : le travail dans cette conserverie de Galice nous ramène à une époque qui semble lointaine et à des manières de procéder entièrement manuelles que l’on suit de gestes en gestes, répétitifs et ininterrompus comme l’est le travail à la chaîne et sa violence. Le temps semble aussi s’être arrêté dans Muebles Aldeguer. Sous le regard attentif d’Irene M. Borrego, le présent devient soudain presque paisible, fait de gestes minimalistes, dans cette petite galerie commerçante où le client se fait rare et où deux hommes dont les silhouettes créent une chorégraphie solitaire de l’abandon, s’emploient à tuer le temps.
Víctor Moreno (La piedra) fixe à son tour son regard sur un outsider de la société, autant local que forain, véritable Sisyphe – l’évocation est immanquable – qui avance pas à pas, peu à peu, obstiné, tout comme le cinéaste construit son film. Deux hommes, le filmé et le filmeur, absorbés à résoudre les obstacles qui surgissent, virant parfois au burlesque, pour imaginer – peut-être ? – un résultat final à leur labeur.
Mutations
Croire en le cinéma en tant qu’expérience de transformation, capable d’altérer les situations et les pensées de ceux qui le regardent, de muer les espaces et les personnes qu’il filme, et de penser sa propre mutation.
Jet Lag d’Eloy Domínguez Serén pose incidemment une multitude de questions sur le fait de filmer un documentaire aujourd’hui. D’une proposition initiale aux allures d’exercice, un événement sort de leur torpeur nocturne dispositif, protagoniste et équipe de réalisation. Se construit alors, dans un espace minimal, un récit cinématographique emporté par le réel.
L’impressionnante métaphore, interprétation libre de l’artiste Greta Alfaro (In ictu oculi) nous propose en un clin d’œil et une séquence quelques lectures possibles de notre monde actuel ; à savoir une vision économique, environnementale, militaire… ou encore, comme dans les fables anciennes, les animaux se font miroir du comportement de l’être humain, prédateur, destructeur.
L’essai d’Elías León Siminani (Límites primera persona), partant d’un supposé film de vacances dans le désert, file et effile sa relation amoureuse, revisite ses images comme un matériau d’archive pour construire avec une perspicace autodérision une lettre filmée toujours à même de transformer les sentiments.
La mise en scène d’Eloy Enciso Cachafeiro (Arraianos) est d’une grande attention à la beauté des corps et des lieux, des visages et des gestes. Le choix de mêler le quotidien à la fable et son désir de conter transfigurent le village. L’invitation à jouer faite aux villageois, leur sérieux et le plaisir qu’ils y trouvent font transparaître leur relation à cette terre et à leur langue, la gravité et la joie d’être là.
Miquel Martí Freixas et Christophe Postic
Débats animés par Miquel Martí Freixas et Christophe Postic.
En présence d'Oskar Alegría, Irene M. Borrego, Eloy Enciso Cachafeiro, Andreas Fontana, Pilar Monsell, Eloy Domínguez Serén,
Avec le soutien de Acción Cultural Española (AC/E), de l’Office Culturel de l’Ambassade d’Espagne à Paris, et de l’Institut Français d’Espagne.