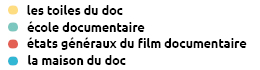2011
2011  Route du doc : Italie
Route du doc : Italie Route du doc : Italie
La présence remarquée en festivals de documentaires italiens n’est sûrement pas révélatrice de la santé du cinéma documentaire en Italie. Y financer un film reste extrêmement difficile, voire impossible hormis le soutien de quelques aides régionales. Ces conditions favorisent parfois l’existence d’un cinéma en marge, en résistance, qui s’inscrit en contrepoint d’écritures plus conventionnelles qui, elles, trouvent plus souvent acheteur. Nous sommes donc partis à la découverte de ces films qui explorent d’autres voies et tentent d’autres formes qui ne sont pas à vendre. Parfois fragiles mais d’une fragilité qui révèle la sensibilité d’un regard, la nécessité d’un engagement, chacun de ces films, à sa manière, trouve une voie, une forme pour se confronter au réel et le raconter.
Si partir à la rencontre est une forme commune du cinéma documentaire, elle demeure une tension promise à l’imprévu, à de l’irréductible : cette personne inconnue ou familière qui se prête ou non, complice ou rebelle, au regard d’une caméra et de celui qui la porte. Quand en 1972, Alberto Grifi et Massimo Sarchielli s’intéressent à Anna, jeune mineure en errance, ce n’est pas sans une certaine instrumentalisation au service d’un sujet potentiellement séduisant. Mais l’effrontée fera voler en éclats le dispositif et son réalisme de laboratoire, divisant l’équipe, les obligeant à prendre position et à affronter autrement le réel. Fin du scénario, début de la vraie vie. Ils poursuivent le film, avec les premières caméras vidéo portables, laissant le réel s’engouffrer dans le film et s’engageant avec Anna dans une relation dont la vérité redevient le cœur du film, un cœur politique. Invisible depuis la dernière projection française à Cannes en 1976, Anna marque un tournant dans l’histoire du cinéma documentaire italien.
Avec Cadenza d’inganno. Récit d’une rencontre interrompue, Leonardo Di Costanzo s’est confronté à la même résistance du réel. Alors qu’il essaie de tisser patiemment une relation avec Antonio, un jeune napolitain, en l’accompagnant dans son quotidien, s’attachant à saisir ses incertitudes de préadolescent, le jeune héros disparaît subitement. Le réalisateur et le film restent en plan. Dix ans plus tard, Antonio, sur le point de se marier, prend des nouvelles du film resté inachevé. Il commence sa nouvelle vie d’adulte et aura finalement décidé pour le réalisateur du moment pour clore l’histoire et faire exister le film. Naples est la cité d’un peuple vivant qui tente de conjurer le sort. Giovanni Cioni arpente les ruelles du purgatoire, ici-bas, et part à sa rencontre. Ils ont tous une histoire à partager, pour nous dire leurs visions du monde et de ce qui les attend, souhaité ou redouté. Chacune de ces rencontres est un fragment de destinée qui prend l’allure d’un corps, d’une voix, d’un lieu, comme autant d’apparitions dont les paroles remplies de croyances et de superstitions, dont les récits de rêves prémonitoires ou de visions, nous entraînent dans ce désir et cet espoir de réchapper du monde et de ses malheurs. Et nous finissons par être persuadés, comme nous l’affirme ce démiurge en cinéma improvisé, que chacun de nous a un rôle bien précis, dans le film comme dans la vie, que « tout ce qui arrive doit arriver » et le film est là pour en juger, In purgatorio.
Ces cinémas que nous avons assemblés composent un voyage dont les variations sont semblables à celles d’un kaléidoscope : une multitude de récits à partir d’images communes, comme autant de façons de tenter d’habiter ou de hanter le monde, de l’observer et de s’y exposer, de lutter contre la séparation et la disparition.
Dans La vita al tempo della morte d’Andrea Caccia, après un premier acte où la beauté de la nature rivalise avec celle de jeunes corps insouciants et téméraires, la mort survient brutalement. Des hommes et des femmes pour qui elle est proche disent leurs peurs et leurs désirs, avant que le cinéaste ne mette en scène l’inventaire du garage de son père disparu en guise de deuil. Trois actes pour trois états de la vie qui s’écoule.
Pour Daniele Segre, dire ce qu’est Mourir de travail se fait d’une manière directe et frontale, sans détour, parce que la violence est trop grande pour vouloir imaginer l’atténuer. Dans la neutralité d’un studio, le réalisateur recueille avec attention les témoignages de ces travailleurs-esclaves. L’accumulation des récits dit la banalisation de leurs conditions et exacerbe encore la violence infligée. Ils viennent livrer avec beaucoup de retenue ce qui pourtant les détruit, pour faire du film une preuve, l’espace d’un combat qui commence par donner à entendre et qui traduit le long engagement du cinéaste de ce côté-ci du cinéma. Tout autrement, Fabrizio Ferraro, met en scène le texte de Simone Weil sur la condition ouvrière. Une comédienne incarne, silencieuse, ce récit porté en voix off, journal documentaire du travail à l’usine. Le choix de la distanciation donne au texte toute son ampleur et les lieux aujourd’hui désaffectés du travail ouvrier, tout comme les paysages urbains contemporains, se remplissent des mots de Simone Weil et donnent au film un caractère intemporel, tout à fait à propos. A Ming complète ce regard sur le travail en accompagnant la journée d’un clandestin chinois à la quête d’un emploi dans les rues de Milan, dont chaque moment raconte, simplement, l’attente, l’inquiétude et le déracinement.
Le paysage de maisons en ruines de Visions de ruines, dans la vallée du Pô, ressemblerait à un désert s’il n’était peuplé des récits de ceux qui sont restés, enracinés à leur terre. La traversée en train d’où défilent de longues bandes de campagne s’interrompt pour des rencontres d’où naissent ces récits qui s’entremêlent au commentaire de l’écrivain-réalisateur Gianni Celati, et à la présence sage de John Berger nous contant comment nos sociétés capitalistes ne peuvent accepter de cohabiter avec les ruines. Autre déambulation, Alice Guareschi vague à travers le monde pour Bianco Giallo Rosso e Nero. Un'avventura cromatica. C’est un film en suspension, qui ne fuit pas les clichés mais s’en saisit simplement, les aplanit pour les rendre à leurs territoires d’appartenance, à leur couleur d’existence. Se laisser happer par les lieux, dans une forme d’attente entièrement dévolue au regard. Les rencontres y sont fortuites et éphémères, acceptées sans plus de curiosité par ceux qui sont filmés dans un quotidien anodin. La même fascination pour le regard et l’observation caractérise Un jour à Marseille. Une seule journée pour capter la sensation d’une ville ne relève ni de la performance ni de la facilité mais d’un désir d’imprégnation. D’un voyeurisme de circonstance, Mauro Santini scrute les errants de la nuit depuis une chambre au travers des persiennes. Puis il sort au grand jour, s’attardant longuement, s’attachant à des lieux et à ceux qui sont là, vendeur, promeneur, à distance mais présent, attentif ou intrigué, perméable à ce qui se passe devant la caméra. Plus replié et en miroir, Una casa vista da una casa est un film de « façades » où le monde est une apparition derrière une fenêtre ou sur un balcon, dans une lumière ou un reflet, avant de ressurgir de l’intérieur, du son d’une radio. Le cœur de la ville est une intrigue, les vies s’y croisent et semblent parfois impénétrables. Alors les films essaient de l’habiter.
Avec 120 mt. slm (120 metri sul livello del mare), Giuseppe Baresi planifie sa tentative de saisir les frontières de la ville et d’en comprendre le système, par l’inventaire systématique de ses points d’entrée. Mais la ville grandit par elle-même, elle échappe à toute logique ; ses lignes s’entrecroisent et le film se perd dans ses méandres. 42 storie da un edificio mondo, mélange de réel et d’animation, raconte la ville par le microcosme d’un immeuble dont n’est filmée que la cour, mais dont les sons et les dessins animés déploient tout l’univers caché.
L’Estate vola d’Andrea Caccia est une traversée hallucinée de Milan, dans le regard extraterrestre d’un migrant sur l’agitation du monde, un petit poème amoureux et ludique d’où surgissent dans une foultitude d’images et de sensations des visages qui nous regardent et nous inviteraient à nous arrêter là un instant, pour parler du temps qui passe.
Dans le monde dépeuplé de Mammaliturchi ! – cri d’effroi qui signale l’invasion des Turcs au Moyen Âge, repris ironiquement et tragiquement aujourd’hui pour désigner l’arrivée de migrants sur la côte – ne restent que les vestiges d’un lieu de rétention qu’un œil mécanique semble explorer, à la recherche d’une trace humaine. Mais les hommes migrants ont disparu, les rares objets abandonnés évoquent une fuite précipitée et la mer sombre, un déluge de fin du monde…
Circo Togni Home Movies est une autre forme de mémoire, exhumée par l’association Home Movies, qui archive, restaure et monte des films de famille Super 8. Des récits renaissent dans d’autres mains, par d’autres regards. L’exercice est parfois délicat mais on décèle souvent dans ces images intimes, un désir fragile et tâtonnant de construire un récit, de l’adresser à quelqu’un d’autre que soi. Chiara Malta joint ce désir au sien dans une fantaisie espiègle de la féminité pour affirmer : J’attends une femme.
Il n'y aura pas la guerre ! est la rencontre inespérée des vivants après les morts. Peu de cinéastes sont retournés en ex-Yougoslavie ces dernières années pour y sonder les traces de la guerre. Daniele Gaglianone nous y plonge littéralement, par longs blocs de rencontres, neuf chapitres d’une densité à la mesure de la maturité de la parole qui se donne au film. Ceux et celles qu’il rencontre en Bosnie nous racontent cette expérience indépassable qu’ils surmontent aujourd’hui quotidiennement. À chaque nouveau chapitre, la mise en scène diffère et s’accorde à la personne et à son récit : un lieu, une langue, un cadre, un mouvement qui renforcent l’intégrité de leurs témoignages. Si les plaies sont encore ouvertes, les paroles de ces hommes et de ces femmes ne cherchent pas à raviver la douleur, ni à l’atténuer. Elles sont brûlantes et leurs voix continueront de nous habiter longtemps, de garder vivante la mémoire des morts et de nous rappeler la force des vivants.
Palazzo delle Aquile marque un retour au cinéma direct d’une belle manière qui se fait rare dans le documentaire. Stefano Savona, Alessia Porto et Ester Sparatore filment une lutte de l’intérieur, au plus proche et au quotidien : occupé par des groupes de sans-logis, le palais de la mairie de Palerme devient le théâtre de leur révolte, de leurs rivalités et la manifestation du cynisme et de la trahison des politiques. Et si cette forme d’un cinéma de l’immersion et de l’engagement, au-delà de l’idéologie, s’impose ici, c’est qu’elle reste une forme ouverte au réel, où expérience de vie et expérience du cinéma sont politiquement liées. Être là avec eux et filmer. Une forme qui refuse d’enfermer le réel parce que l’histoire ne s’arrête pas avec le film.
Christophe Postic et Federico Rossin
Débats et présentations par Christophe Postic et Federico Rossin, en présence d'Andrea Caccia (réalisateur), Daniele Gaglianone (réalisateur), Stefano Savona (réalisateur), Daniele Segre (réalisateur), Gianmarco Torri (Home Movies).