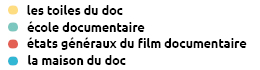2006
2006  Territoires du sonore
Territoires du sonore Territoires du sonore
Préliminaires
Il est entendu que Chaplin a résisté à l’avènement du parlant pour préserver Charlot. En revanche, il est faux de prêter au cinéaste l’idée que les films pouvaient continuer d’être muets. En 1935, l’industrie du cinéma américain est entièrement passée au sonore. Les exploitants n’ayant pas les moyens d’investir dans l’équipement de leur salle les vendent aux grandes compagnies, les coûts de fabrication des films augmentent. Il est certain que Chaplin a atermoyé : Charlot est un mime. Il lui fallait comprendre sur le vif comment évoluait le marché pour savoir comment le vagabond muet pouvait continuer de vivre – on ne peut pas dire vagabond analphabète, car si ce terme correspond à une détermination plausible du personnage, il ne dit rien de son inscription dans le monde « à fleur de peau » : les mots lui manquent, comme ils manquent à quiconque est dépassé par les événements. Il ne parvient plus à les nommer, et d’ailleurs, il ressent plus les choses et le monde qu’il ne les pense. Cela étant, on sous-estime l’adieu de Chaplin à Charlot lorsqu’on le rabat sur cette révolution technique comme sur une raison en dernière instance. Je crois que Chaplin a vivement conscience que l’arrivée du son implique un déplacement politique des formes du récit.
Pour le dire autrement, je ne vois pas pourquoi les cinéastes du muet auraient été sourds. Au contraire, tout indique qu’en explorant les puissances de la mise en scène, ils entendaient résonner les sons. Cela va des comédiens qui profèrent leur texte (on sait que les sourds-muets, lisant sur les lèvres, se gondolaient, mais ce décalage appartenait d’emblée aux effets de lecture de la mise en scène avec lesquels les cinéastes jouaient) à l’inscription dans les plans des résonances de maints objets — que ce soit des gros plans explicites des sources sonores, telle la sonnette de la porte que la tête qui se redresse, ou de ces milliers de chocs implicites disséminés dans les plans.
La question qui se pose à Charlot est d’abord celle de la voix, plus encore que celle de la façon dont le monde sonne. Quatre ans séparent Les Temps modernes, 1936, et Le Dictateur, 1940. Dans ce premier film parlant — le langage ordinaire enregistre combien le problème est moins le sonore, mais comment ça parle -, la fable de son époque s’accommode de la rareté des mots et de l’esperanto derrière lequel s’abrite l’ouvrier vagabond lorsqu’il chante. Qui plus est, il comprend comme Fritz Lang, que l’exercice du pouvoir est inséparable de l’abolition de la distance et de la séparation par la télé-vision. Autrement dit, Chaplin est contemporain d’un double mouvement : la montée du nazisme avec ses mises en scène des nouvelles techniques du pouvoir, et la fixation des récits dans le carcan des dialogues et de leur synchronisme. Le dictateur, ce n’est pas exactement Hitler, mais plutôt le Führer, c’est-à-dire une fonction que les techniques modernes favorisent.
Soit dit en passant, ces nouvelles procédures de l’administration du pouvoir ne sont pas sans rapport avec le fait que l’enregistrement du son relève d’un procédé optique : il est objectivé le long de la pellicule en une longue sinusoïde d’intensités gravées en noir. Si le synchronisme est la clé de sa transparence technique, son dessin est la clé d’un renversement inouï, la possibilité de fabriquer un son synthétique, a fortiori une voix artificielle. C’est ce à quoi s’emploie en Allemagne à la toute fin des années vingt, Rudolf Pfenninger, un ingénieur qui travaille pour la Emelka (les premières démonstrations filmiques circulent en Europe à partir de 1932). Que de l’intérieur même du synchronisme on puisse en arriver à se passer de toute source référée à une présence, une origine, un événement, voilà mise au point une puissante machine de pouvoir que seul Lang a visualisé à travers la figure de Mabuse.
Quant à la question de savoir ce qui exactement sonne dans un plan, ce que l’on bruite, elle est abordée par Chaplin (à l’instar des autres cinéastes) en terme d’illustration sonore privilégiant un son unique, par le choix d’un son métonymique – dont la rareté sonne souvent de façon poétique à notre oreille saturée d’aujourd’hui.
On peut dire que dans un premier temps, le cinéma a repoussé les sons plus encore qu’il les a contrôlés. La raison de ce phénomène tient à cet effet inhérent au son de donner un poids, une matière, une densité aux choses et aux corps, de sorte que les films ont préféré rêver les sons que les rendre avec précision. Ce que le cinéma – tel qu’Hollywood l’invente – a cherché à éviter, c’est de laisser le réel le pénétrer, l’envahir, l’inspirer.
Le meilleur symptôme en est deux phénomènes concomitants à la révolution sonore. D’une part, quand la Fox, quelques mois avant Le Chanteur de Jazz (1927), développe un système d’enregistrement optique, c’est pour lancer sur le marché une nouvelle forme d’actualités filmées, les Fox Movietones, qui se distinguent par le supplément de réalité que leur prête le son synchrone. D’autre part, ce qui fait le succès du sonore du côté de la fiction, ce n’est pas ce supplément de réalité, c’est au contraire l’explosion d’un nouveau genre où l’artifice est roi : la comédie musicale. Il n’est d’ailleurs pas indifférent que ce soit une comédie musicale qui, en 1952, raconte cette révolution sonore, dans une mélancolie qui s’ignore à l’époque même de l’arrivée de la télévision, Singin’ in the Rain. Autrement dit, on peut émettre l’hypothèse que le fossé entre le documentaire et la fiction s’est creusé, et peut-être défini, avec l’apparition du sonore.
Entre-temps, avec la seconde guerre mondiale, est apparu un nouveau système d’enregistrement qui libère le son de toute pesanteur technique, de l’asservissement au studio : la bande magnétique. Or, avec ce procédé s’opère un renversement sonore duquel nous ne sommes pas sortis et qui est au cœur de la problématique documentaire : la capacité d’enregistrer les événements au moment de leur irruption. Avec sa contrepartie, l’impossibilité de trier les sons : tous, ils s’agglutinent indifféremment sur la bande, sans discrimination.
De sorte que l’on est passé d’une puissante machine de pouvoir en studio où les bruits du monde avaient du mal à pénétrer, à une autre machine, un appareil de pouvoir, aussi redoutable, où les éclats du monde saturent et génèrent du bruit, empêchant le silence de s’installer pour faire entendre les sons.
On devrait faire une histoire du XXe siècle à partir de la maîtrise de l’enregistrement du son pour comprendre pourquoi nous sommes sourds, pourquoi nous ne sommes pas nés au son.
Deux obstacles perdurent aujourd’hui quant à la façon de traiter le son dans les films. Le premier est que le son administre la preuve de la réalité des choses en leur prêtant des qualités matérielles. Derrière cette question de la synchronicité, on touche à l’une des grandes croyances du documentaire, à savoir qu’il serait un cinéma du réel. Le second est de considérer les sons comme un matériel musical à part entière. Ce qui fut un enjeu des futuristes jusqu’à Pierre Schaeffer et John Cage ne peut aujourd’hui continuer à se formuler de la même manière. Dans les deux cas, ce qui n’est pas pensé, c’est en quoi un son est l’affirmation d’un point de vue à partir d’un point d’écoute, c’est-à-dire en quoi le traitement du son relève d’une dramaturgie et a fortiori d’une poétique.
Nous nous trouvons aujourd’hui face à deux tâches. D’une part, apprendre à écouter les sons pour comprendre comment les faire circuler dans un film. Cela relève de la maîtrise de nos pratiques. D’autre part, tenter de comprendre les raisons qui ont fait du son l’un des grands vecteurs du recouvrement du monde, une puissante technologie de brouillage dont on sent confusément qu’elle empêche de penser, de rêver, de se projeter au-delà de l’immédiateté. À cet égard, la généralisation du son enregistré par le micro caméra, à la faveur de la banalisation des caméras domestiques, relève d’une critique de la rationalité technique. Cette idéologie masque l’enjeu esthétique et politique de la médiation technologique autant que son idéal hyper-réaliste.
(De prime abord, le son apporte un supplément de réel aux films. Parce qu’un choc, par rapport au corps plume du muet, c’est une masse et de l’air, c’est un supplément de présence mais il n’est pas toute la présence (qui, elle, passe par le toucher, le goût et l’odorat, c’est-à-dire par la dévoration gastronomique). Avec le sonore, les cinéastes ont dû apprendre à partir de l’écoute pour découvrir le plan.
Il faut écouter pour savoir comment regarder.)
Jean Breschand
Écoutes
Et si l’on considérait le cinéma comme une gigantesque machine à faire entendre ? Une machine qui s’aiderait de l’image pour désigner et préciser l’écoute, une machine à dire le monde, conçue pour nous permettre de nous entendre ?
Dans ce cas, comment opérer, comment capter le son précaire du direct dans la durée du plan ? Comment saisir ce que confortera le cadre, comment parvenir à révéler le son qui est là et déjà nous déborde. L’expérience, si difficile à inscrire dans le temps de l’image, présente tant d’aléas que nombre de cinéastes préfèrent la différer. « On pensera le son après » est peu à peu apparu comme une loi. On revendique aujourd’hui comme un choix ce que l’on subissait encore hier.
Alors, pour tenter d’apercevoir ce qui se passe, il faut démonter les méthodes de saisie, il faut déconstruire le sonore du réel pour apprendre à le reconstruire. Ecoutons ! Car ce dont nous sommes sûrs, c’est bien de notre écoute. C’est par la comparaison que nous allons entendre ce que le micro nous révèle du réel.
Face à la complexité et la diversité des matériaux, il faut d’abord organiser les points de vue. Où situer le point d’écoute ? Choisir comment les sons se révèlent dans la distance : choisir les fonds d’air, décider de l’épaisseur ou de la transparence d’un lointain ou alors préférer la clarté des sons seuls ?
La confiance dans les sons du monde s’exprime bien dans la pensée de leur réagencement. Le choix des protocoles de prise, comme celui des outils, s’associent, façonnant les esthétiques.
Et si les voix sont nécessaires pour révéler ce qui ne nous parviendrait pas, où donc les situer ? Les voix des films de Jean Rouch ne sont pas celles de Chris Marker, celles de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet bien loin de celles de Jean-Daniel Pollet. Ni le principe d’élocution, ni le mode de narration ne peuvent être réglés une fois pour toutes. Les conditions d’émergence de la parole ne s’affirment jamais par une même nécessité.
Désignant aussi un lieu du sensible du film, l’ancrage de la musique s’inscrit comme une parole. Par le superlatif ou dans la simple évanescence, la musique occupe sa part du point de vue. Elle peut partager sa place avec les sons du monde (Le Territoire des autres) ou être sillonnée : se laissant voir partiellement comme l’est tout paysage traversé (Conversation).
Vient enfin la nécessité d’élaborer la méthode, pour organiser les couches, les coupures, les ellipses. Comment combiner, associer ces moteurs, ceux qui si discrètement organisent l’énergie filmique ? Comment ces nécessités prennent en charge ce qui du film apparaît le moins mais qui constitue certainement l’outil le plus efficace de l’organisation de la vision ?
Daniel Deshays
Au cours de chaque séance, de nombreux extraits de films serviront de supports à la réflexion.
Coordination : Daniel Deshays, Jean Breschand