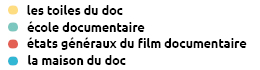2018
2018  Sauve qui peut le cinéma direct / Séminaire
Sauve qui peut le cinéma direct / Séminaire Sauve qui peut le cinéma direct / Séminaire
En cours de route
Le séminaire « Sauve qui peut le cinéma direct » est parti d’un questionnement que l’on peut résumer ainsi : peut-on encore faire du cinéma direct ? Cette interrogation a, depuis sa diffusion, engendré des réactions contradictoires, à commencer par celle de l’un des réalisateurs conviés, Nicolas Philibert, m’affirmant qu’il n’avait pas « l’impression de faire du cinéma direct ». Deux autres participants à cette rencontre, enseignants-chercheurs, ont manifesté leurs interrogations à la lecture de mon texte, le trouvant pour l’un d’entre eux « trop rhétorique » et m’incitant à envisager le cinéma direct « comme une matrice » à même d’évoluer (voir textes ci-après). Par la suite, la scénariste Cécile Vargaftig, en train de participer au tournage d’un film réalisé par Valérie Minetto à Saint-Denis sur le mode de Chronique d’un été (1961) de Jean Rouch et Edgar Morin, m’a fait part des difficultés auxquelles elle était confrontée, échos selon elle à certaines de mes réflexions : « ils s’adressent directement à la caméra et ne répondent pas à mes demandes ». Décrivant les méfaits d’un direct permanent sur lequel chacun peut se connecter, elle évoque dans un texte « la sensation que le réel est tellement saturé d’images qu’il en a perdu son aura ». Puis vint le tour de Denis Gheerbrant, réalisateur de films documentaires, qui commença par m’indiquer qu’il avait souvent été confronté à des suggestions du style « le cinéma direct, ça va bien, il serait temps de passer à autre chose », occasion pour lui de revendiquer cette approche cinématographique afin, m’expliqua-t-il, « de filmer des gens pour qui la parole est une lutte ». Un autre ami réalisateur me suggéra la lecture d’un livre de Séverine Graff, Le Cinéma-vérité, films et controverses, dans lequel j’ai trouvé des propos d’Edgar Morin définissant la démarche du « cinéma vérité » : proposer « à chacun de jouer sa vie devant la caméra », inventer un « cinéma de fraternité », « briser cette membrane qui nous isole chacun les uns des autres ». Il y est aussi question, en faisant confiance au regard d’ethnologue de Jean Rouch, d’un refus d’embellir la réalité que l’on filme et d’une volonté de s’y immerger tel « un cinéaste-scaphandrier »… À propos des Inconnus de la terre (1961) de Mario Ruspoli, qui se revendique de la lignée du « cinéma direct », Séverine Graff évoque l’objectif « d’effacement du cinéaste au profit d’une “immersion directe” du spectateur dans la réalité ». En parallèle, je revois In the Street, le film magnifique de Helen Levitt, Janice Loeb et James Agee réalisé à New York en 1948, dont j’apprends que certaines séquences tournées dans les rues de Spanish Harlem l’ont été en caméra cachée, comme d’autres de Chronique d’un été… Je découvre le nouveau film de Claire Simon, Premières solitudes, réalisé avec des lycéens d’Ivry-sur-Seine, au cours duquel on les voit se questionner les uns les autres sur un mode intime dans un registre qui entrelace documentaire et fiction. Entretemps, je m’interroge sur les termes utilisés : « cinéma vérité », comme si le reste était mensonge ; « cinéma direct », manière d’indiquer que les autres films capteraient la réalité à travers un filtre probablement déformant ; « living camera », laissant supposer que les autres sont mortes, sans parler de l’expression « candid eye » (renvoyant à une émission américaine de « caméra cachée »), dont on finit par ne plus savoir s’il s’agit d’évoquer le regard du filmeur ou celui du filmé : candeur masquant quelle perversion ? À chaque intitulé sa propre mythologie, qui peut paraître un peu naïve, comme souvent, avec le recul du temps. Demeure la question à l’origine de ce projet : comment peut-on filmer l’autre dans une réalité bien différente de celle au sein de laquelle a émergé le cinéma direct ? Ce qui relevait, me semble-t-il, d’une certaine forme d’utopie ou d’innocence liée à un contexte, celui de l’après deuxième guerre mondiale, est-il transposable aujourd’hui ? L’usage de nouveaux instruments du cinéma permettant l’enregistrement sonore en direct, puis de manière synchrone, tels qu’ils ont été progressivement maîtrisés au début des années soixante est depuis devenu monnaie courante, au point qu’avec l’usage massif des technologies numériques, chacun a conscience de l’effet produit et le maîtrise. D’une façon plus complexe à définir, la manière dont nous concevons, individuellement ou collectivement, notre rapport à l’autre, au temps, à l’espace, paraît bien différent plus d’un demi-siècle plus tard, tout comme notre relation aux images – celles que nous voyons, celles que nous produisons. Selon quelles modalités est-il dès lors envisageable de filmer l’autre afin d’obtenir une matière produisant du sens, un récit partageable avec des spectateurs ?
Perdant un peu le nord après ces suggestions et questionnements divers, je décide d’aller marcher et tombe sur un groupe de tatoués devant le salon situé en bas de chez moi. Je m’interroge sur ce phénomène de plus en plus répandu (notamment sur les corps de ceux qui s’y adonnent). Peur d’être transparent ? Armure pour se protéger du monde ? Crainte d’être mis à nu ? Parure narcissique ? Signe de reconnaissance ? Je ne peux m’empêcher d’y voir l’expression d’une vanité. Celle d’être sûr que le désir qui advient dans le présent sera éternel (il y a dans le tatouage un geste de l’ordre de l’irréversible). Je crois y percevoir un double symptôme : l’un révélant que notre rapport au temps est en crise, obnubilé par l’instant, désinscrit de toute temporalité longue ; l’autre indiquant que notre relation à l’autre, au monde, s’avère plus ou moins brouillée. Que peut le cinéma documentaire, et sous quelle forme, face à ce repli sur soi, sur l’immédiat, puisque le geste cinématographique est avant tout inscription dans un autre espace, un autre temps, un autre monde que celui dans lequel on vit, porteur d’une petite part d’éternité qui nous échappe ? L’énoncé des titres des trois films récents que nous présenterons dans le cadre de ce séminaire – De chaque instant de Nicolas Philibert, Nul homme n’est une île de Dominique Marchais et Va, Toto ! de Pierre Creton – ainsi mis bout à bout, résonne comme une réponse possible au présent.
Frédéric Sabouraud
Mais d’abord… qu’est-ce que le cinéma direct ? Pour répondre à cette question, un retour aux sources s’impose effectivement, qui nous permettra de faire le constat d’une diversité formelle qui rend impossible de le réduire à un seul style. Ici ou là, les films de cinéma direct de la première heure ont expérimenté une multitude de dispositifs critiques ou réflexifs (la mise en scène par sélection, la mise en situation ou la mise en présence, le feedback et la scénarisation au montage), se saisissant de nouveaux outils, forgés selon leur désir, pour initier un nouveau rapport entre le vécu et le cinéma qui n’exclut en rien la mise en scène, encore moins la fiction.
Ce cinéma plus direct tient sa force critique des modalités du différé qu’il déploie : la mise en scène de l’attente qui suscite la fabulation, le retour sur soi, l’effort de mémoire (La Bête lumineuse, Pour la suite du monde de Pierre Perrault), l’exploration de l’écart entre l’événement et son double médiatique (Primary, Crisis des Drew Associates), la dramatisation du quotidien et la stratification du temps dans l’après-coup du montage (Salesman des frères Maysles), le retour sur l’expérience du tournage (Chronique d’un été de Jean Rouch et Edgar Morin, Méthode 1 de Mario Ruspoli). Louis Marcorelles l’écrivait en 1970 (Éléments pour un nouveau cinéma, Unesco, Paris, 1970) : « C’est dire que le direct est le contraire du simple immédiat, il réinstaure la médiation réelle qui s’élabore dans toute entreprise de connaissance. »
À partir de ce constat nous proposerons l’hypothèse que le moment émergent du cinéma direct constitue tout à la fois un retour aux origines du cinéma, en rejouant la dramaturgie du regard qui fonde « l’esthétique de la vue » (Tom Gunning), et une matrice pour le documentaire moderne. Ainsi nous pourrons, en prenant appui sur les films et les discours de documentaristes contemporains, en appréhender les contours et l’héritage, et en questionner la pertinence. Ce faisant, nous nous demanderons si l’abondance des images et la défiance qui l’accompagne n’appellent pas au contraire un retour au temps et à l’acuité du cinéma direct. Et si l’en-deçà des discours qu’il propose n’est pas de nature à accompagner un renouvellement du politique nécessaire et déjà souterrainement à l’œuvre.
Caroline Zéau
Le cinéma direct peut sans doute être défini comme une technique : la possibilité d’enregistrer l’image et le son synchrone avec du matériel léger, dans des conditions documentaires. À y regarder de près, c’est déjà moins simple qu’il n’y paraît : ce dispositif fondamental a connu de nombreuses variantes au cours de l’histoire, et les films considérés comme les modèles du « direct » ne répondaient pas toujours précisément à ces critères. Ceux-ci, d’ailleurs, ne sont eux-mêmes peut-être pas si évidents qu’on pourrait le croire. Par exemple, qu’est-ce finalement que du « matériel léger » ? Mais aussi, son direct et son synchrone, est-ce rigoureusement la même chose ? On pourrait alors effectivement aller y regarder de plus près, pour se demander ce qu’ont été exactement les techniques du « direct » : quels appareils, quelles configurations de tournage, quelles inventions et quels problèmes ont été décisifs. Interroger l’actualité du cinéma direct, de ce point de vue, signifierait se demander ce qu’il en est, aujourd’hui, de ces problèmes : sont-ils définitivement résolus, remplacés par d’autres qui seraient sans commune mesure ?
Mais ces questions ne peuvent être strictement techniques. Elles engagent tout le cinéma, et au-delà. Montrer les gens dans leur vie ou dans leur travail, enregistrer leurs paroles et leurs gestes, leurs corps et leurs mouvements, c’est une histoire qui remonte au moins aux débuts du cinéma, même aux débuts de la photographie, et de l’enregistrement sonore. Dès le commencement du vingtième siècle, les images sont partout : on les archive et on les échange, on filme dans les rues et on se met en scène devant l’appareil – on se met en scène déjà sous le regard de l’autre, avec les images réelles ou imaginaires qui nous modèlent.
Ces questions engagent donc une histoire et une archéologie, mais elles renvoient aussi à une géographie. Dès son émergence et jusque dans les années soixante-dix, l’Unesco a été l’un des grands promoteurs du cinéma direct, léger et synchrone. Avant d’être une forme documentaire, le « direct » a peut-être surtout été un cinéma pauvre, accessible à (presque) toutes les nations, dans (presque) tous les contextes, permettant une certaine autonomie, économique, technique et donc culturelle et politique. Aujourd’hui, c’est d’abord dans ces contextes que la valeur du « direct » doit se mesurer, sur un plan qui ne cesse de mêler esthétique et politique.
Benoît Turquety
Déroulé du séminaire
Lundi 20 à 10h00 :
Introduction puis projection de La Bête Lumineuse de Pierre Perrault.
Lundi 20 à 14h30 :
Retour sur l’histoire du cinéma direct.
Interventions et discussions avec Fréderic Sabouraud, Benoît Turquety, Caroline Zéau.
Avec la participation de Dominique Marchais et Nicolas Philibert.
Lundi 20 à 21h15 :
Projection de De chaque instant de Nicolas Philibert suivie d’un débat.
Mardi 21 à 10h00 :
Projection de Nul homme n’est une île de Dominique Marchais suivie d’un débat.
Mardi 21 à 14h30 :
Le cinéma direct aujourd’hui.
Interventions et discussions avec Fréderic Sabouraud, Benoît Turquety, Caroline Zéau.
Avec la participation de Dominique Marchais et Nicolas Philibert.
Mardi 21 à 21h00 :
Projection de Va, Toto ! de Pierre Creton.
Coordination : Frédéric Sabouraud.
Avec Dominique Marchais, Nicolas Philibert, Benoît Turquety, Caroline Zéau.