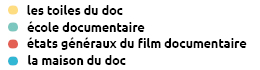2018
2018  Sur « le point de voir » / Ateliers
Sur « le point de voir » / Ateliers Sur « le point de voir » / Ateliers
1 / Chantier public
Jeudi 23 à 21h00, Salle des fêtes
Le cinéma et la mémoire entretiennent une relation particulière. Enregistrer le réel nous rassure dans l’idée que nous maîtrisons le temps (et les idées) en fixant des instants qui nous paraissent mériter une forme de postérité. Souvent, nous envisageons le cinéma à l’aune de son procédé, fabrication d’un film puis projection. Ce dernier stade produit un phénomène de contre-champ qui sonne comme une évidence mais que nous pouvons aborder sous cet angle : l’expérience du public, sa pérennité et l’hypothèse de son obsolescence puisque le réel, c’est le spectateur. Pour la trentième édition des États généraux du film documentaire, l’équipe a eu le désir d’initier un temps collectif qui évoque le rôle des spectateurs et génère le récit de l’expérience Lussas, pour et par les habitants du festival eux-mêmes. L’idée n’est pas de conjurer l’inexorable expérience du temps. Il s’agirait plutôt d’activer, à travers des témoignages en forme d’assemblée participative, la relation vivante que nous entretenons avec les films, le festival et, peut-être, d’une manière secrètement plus fondamentale, de reformuler la question du statut du cinéma (documentaire ?), voire sa raison d’être, au regard de ceux qui le regardent. Cette soirée particulière invite le public des États généraux à partager son expérience. Il s’agira de guider la parole, le regard, la perception, avec un dispositif qui transforme et parfois interprète les témoignages, un glissement poétique, une mise en forme du souvenir, qui peut révéler la parenté secrète entre la fabrication et la vision d’un film. Le mot « projection » définit l’exposition physique d’un film sur un écran ; il définit aussi la relation du spectateur qui s’expose, se projette donc dans une situation filmique, qu’elle soit fictive ou documentaire. La soirée « Chantier public » sera une occasion d’exposer les souvenirs de chacun, de la phobie d’un campeur à un débat multi-sémantique, une façon de projeter une partie de soi-même pour dessiner les contours d’un état général à Lussas.
César Vayssié
Conception : César Vayssié,
en collaboration avec Monique Peyrière,
avec la participation d’Anna Perrin
et l’aide de Bérénice Barbillat.
2 / Les gestes du Moindre Geste
Vendredi 24 à 10h00, Salle des fêtes
J’avais trente ans.
Après mes études secondaires à Marseille et l’expérience de l’éducation nouvelle, mon diplôme d’opérateur de l’Idhec[1] et dix-huit mois au Service Cinéma des Armées à la fin de la guerre d’Algérie, je venais d’accepter d’insérer mon travail cinématographique dans le cadre de l’éducation populaire de l’État. Mai 68 résonnait encore très fort. Je me proposais de prolonger les démarches pédagogiques initiées à la fin de la guerre dans les « stages de réalisation[2] », en les inscrivant dans la vie quotidienne de la population des banlieues populaires de Marseille, ma ville !
Les gestes du cinéma venaient d’être bouleversés par l’apparition de caméras 16 mm légères, autosilencieuses et synchronisables avec des magnétophones autonomes et portables. J’avais préparé ce type de matériel, avec Ghislain Clocquet[3], pour le tournage du film Vive le Tour ! de Louis Malle. Chris Marker venait de réaliser Le Joli Mai, Pour la suite du monde de Michel Brault et Pierre Perrault venait de nous envahir, Jean Rouch apparaissait et Jacques Rozier me faisait rêver avec Adieu Philippine.
C’est alors que je suis interpellé, dans le cadre de ma mission de CTP cinéma[4], par un directeur de centre social. Il cherchait « un technicien du cinéma, susceptible d’effectuer gratuitement le montage des éléments d’un film tourné cinq ans plus tôt et abandonné depuis. Il s’agissait d’un travail réalisé avec un jeune psychotique par un petit groupe vivant dans les Cévennes autour d’un éducateur, Fernand Deligny. Trois ans de tournage, dix heures d’images et cinq heures de sons, enregistrés avec du matériel de cinéma d’amateur, 16 mm. » L’ensemble de ces éléments était contenu dans une cantine en fer, bleue. J’ai décidé d’ouvrir cette cantine.
L’expérience que j’ai commencé à vivre alors s’est terminée deux ans plus tard, en 1971, par la projection d’un film de long métrage, Le Moindre Geste, à la Semaine de la critique du festival de Cannes. Entre temps, le projet avait reçu l’aide concrète de Chris Marker et de sa coopérative Slon, devenue Iskra. Les ricochets de tous ces gestes n’ont en fait jamais cessé de se prolonger, d’être relancés, jusqu’à aujourd’hui et ce rendez-vous proposé par les États généraux du film documentaire.
L’œuvre de Fernand Deligny n’en finit pas de nous interpeller, comme sa voix, au début du film : « Ici Deligny. Cette espèce de bonhomme, c’est la main d’un garçon de vingt-cinq ans qui l’a tracée, débile profond disent les experts. Tel il est dans Le Moindre Geste, tel il est dans la vie de tous les jours que nous menons ensemble depuis dix ans et plus, tel il est, pour nous, source intarissable de rires aux larmes, quoiqu’il arrive, et, dans ce film, comme dans la vie très quotidienne, porteur d’une parole dont je certifie qu’elle n’est pas la mienne. Peut-on dire qu’elle soit la sienne ? Mais pourquoi faudrait-il que la parole appartienne à quelqu’un, même si ce quelqu’un la prend ? » Alors prendre la parole, donner la parole… faire un film.
J’ai souvent été conduit à raconter les péripéties vécues tout au long de ce montage. J’ai découvert toutes celles qui l’ont précédé, pendant le tournage et sa préparation. Il existe quelques photographies, très peu d’écrits, mais une multitude de récits parfois contradictoires. Je pense avoir suivi toutes ces pistes. Elles ont nourri mes propres récits, ma propre expérience. Je pense en particulier à ma rencontre très tardive, mais décisive, avec celle qui a crée les images du film, Jo Manenti. Elle a vécu quotidiennement cette réalisation avant de s’éloigner du groupe pour devenir psychanalyste. Nous avons refait ensemble tous ces gestes et partagé son attachement au personnage, Yves, jusqu’à partir en voyage avec lui, du côté de Girolata en Corse. Il y a aussi les complices de la bande son, ceux avec qui s’est construit l’équilibre entre la musique des bruits des Cévennes et celle de la voix d’Yves. Des gestes d’écoute au casque, des gestes de potentiomètre, un autre montage : le mixage.
Je rêvais d’inscrire une pratique de création cinématographique dans la vie quotidienne des gens. Je cherchais, pour cela, à inventer des situations pédagogiques où la création artistique resterait centrale sans en être la seule finalité. J’ai entrepris, par hasard, ce film. J’étais bel et bien au cœur d’une de ces situations dont je rêvais. Elle est essentiellement une expérience. J’aime la raconter, la partager. Pourquoi pas aujourd’hui avec le public de Lussas ?
Jean-Pierre Daniel
1. Institut des hautes études cinématographiques.
2. Un lieu, un artiste, un groupe de stagiaires, d’éducateurs militants.
3. Ghislain Clocquet était un chef opérateur reconnu, professeur à l’Idhec, fondateur de l’Insas à Bruxelles.
4. CTP : Conseiller Technique et Pédagogique du Ministère de la Jeunesse et des sports.
3 / « L’œil écoute »
Vendredi 24 à 14h30, Salle des fêtes
Urgence : le mot est associé à celui d’état au sens d’un dispositif généralisé qui répondrait à une nécessité d’instituer la modalité temporelle de la vie en commun, celle qui impose de ne pouvoir attendre pour opérer. Urgence est le mot qui interdit toute lenteur et donc toute réflexion sous peine d’être coupable et responsable du pire pour avoir agi trop tard ou pas agi du tout. Mais dans le mot état, je pense qu’il nous faut entendre plus exactement aujourd’hui la nature étatique de l’urgence promue par le dispositif de pouvoir qui utilise la double pression de la peur et de la culpabilité. L’état d’urgence n’est qu’un urgentisme d’État en tant que système de gouvernement. Agir sans plus attendre, nous dit-on. Il faut entendre en vérité sans plus entendre, c’est-à-dire sans prendre le temps d’écouter la voix de celles et ceux qui, depuis le silence qui leur est imposé, ont su trouver les formes expressives de leur résistance, de leur révolte, mais aussi de leur liberté. Mais écouter demande du temps et c’est ce temps qui nous est confisqué puisque, comme l’écrivait Benjamin Franklin, « le temps, c’est de l’argent ». Perdre du temps, c’est perdre de l’argent. Il est donc urgent de nous réapproprier le temps pour pouvoir en donner et pour en faire la racine de toute hospitalité. C’est dans tous les champs de la souffrance sociale et de la souffrance psychique, face à tous les dérèglements de la violence, qu’il nous faut construire le temps de l’écoute et laisser éclore la parole de toutes celles et de tous ceux qui sont sans voix. « Sans voix au chapitre », dit-on trivialement. Alors, nous allons prendre le temps d’ouvrir le chapitre en faisant sortir de l’invisibilité et du silence la voix de celles et de ceux qui font surgir devant nous, spectateurs et auditeurs, dans les formes diverses d’un appel, la figure de notre vérité. De quelle vérité s’agit-il ? De celle qui doit composer l’horizon de nos gestes d’accueil, de celle sans laquelle aucune idée de l’humanité ne pourra composer un monde, un monde commun. Accueil de l’enfant autiste, accueil du poète mutique, accueil du fanatique foudroyant et foudroyé, accueil de l’émigré, de l’exilé. Accueil des paroles, des langues, des poèmes et des chants mais aussi accueil des images où se mêlent la douleur et la joie. Nous allons prendre le temps d’en donner, de donner du temps à ces voix d’abord inaudibles qui soudain trouvent la scène de leur déploiement à la fois douloureux, intempestif et joyeux. La voix des sans voix auxquels les impérialismes pseudo-démocratiques demandent leurs voix pour prendre le pouvoir, et auxquels ils l’enlèvent pour le garder, cette voix se rebelle et fait la démonstration de son autorité. L’ouverture de la journée avec l’œuvre de Deligny est d’emblée une introduction politique car si Deligny a su « entendre » le silence de l’autiste, c’est à partir d’un refus radical du bourdonnement assourdissant de l’ordre médical et de tout pouvoir normatif. La radicalité n’est pas là où on la montre pour la condamner, mais au contraire dans la confiance irréductible que nous faisons aux énergies résistantes et créatrices. Nous cheminerons en compagnie de Babouillec, immense poétesse sans voix, nous irons à la rencontre des prétendus radicalisés quand ils sortent de leur silence, nous croiserons Altman quand il se saisit massivement de la bande son de ce que Debord nomma La Société du spectacle pour en montrer et faire entendre la puissance écrasante et mortifère. Le silence des corps colonisés et la force inouïe de leurs voix hantent Pasolini en Afrique mais aussi les Gianikian, qui firent un prodigieux travail sur les archives silencieuses des années vingt en sortant de l’invisibilité les regards et les gestes des peuples sans voix et en confiant à Giovanna Marini la charge de faire entendre le chant qui nous relie pour toujours à cette histoire. Viendra aussi la voix des refugiés et des exilés auxquels Miléna Kartowski-Aïach offrira la scène de leur expression et le témoignage de son partage (voir performance ci-après). Voix aussi des tribus oubliées qui demandent aux signes ce que leur voix renonce à faire entendre.
Partout, le temps donné à l’écoute de ces clameurs ou de ces bruissements multiples devrait devenir une expérience partagée de l’hospitalité.
Ouvrant la journée avec Deligny, qui récuse l’hôpital pour inventer une véritable hospitalité du tout autre, nous la finirons avec Jean-Daniel Pollet. Sa rencontre dans un hôpital athénien avec l’ancien lépreux Raimondakis devint, avec la collaboration de Maurice Born, l’occasion de tourner l’un des plus beaux films consacrés à l’inhospitalité de l’hôpital et à la profonde et radicale humanité de ceux qui en ont perdu les caractères visibles et conventionnels. La voix de Raimondakis est un terrible et magnifique cri d’alarme, celui d’un prophète de notre présente catastrophe.
Marie José Mondzain
PERFORMANCE
Leros – un cri sourd face au monde
Traversée vocale, poétique et ethnographique.
L’île grecque de Leros, à la pointe du Dodécanèse, face aux côtes turques, est également appelée l’île des Damnés.
Les êtres qui y ont été envoyés de force se sont abîmés sur son sol pour y périr dans l’anonymat. Les patients en psychiatrie, les communistes, les opposants politiques et aujourd’hui les réfugiés, tous ont été enfermés dans les palais italiens fascistes, devenus prisons, hôpitaux et, aujourd’hui, ruines où les chèvres viennent s’abriter.
Mais les invisibles ont chanté face à la mer, ils ont psalmodié leur résistance et pleuré à la lune la tragédie de l’existence. Leurs échos peuplent l’île et les voix nous parviennent si l’on ose enfin les écouter.
C’est ce cri multiple et qui traverse les âges que je suis partie chercher.
Que les voix des damnés chantent jusqu’à nous et crèvent le silence de l’histoire.
Miléna Kartowski-Aïach
4 / Point d’écoute, périphéries du silence
Samedi 25 à 10 h 00 et 14 h 30, Salle des fêtes
Face au sonore, face au silence : une impossible arrogance
Ce n’est pas sur le site de la prise de son que l’on peut étudier le sonore. Ce n’est pas qu’à cet endroit que la richesse de son existence ou que ses flux nous débordent. Si nous surveillons incessamment tous les sons qui émergent, nous n’en possédons heureusement qu’une quelconque conscience. C’est que s’il y en a trop, l’oreille trie, suivant toujours son désir parmi ce qui s’y trouve, incapable d’entendre ce « tout » que le micro retiendra.
Pour pouvoir appréhender le son, l’écart est nécessaire. Il faut s’éloigner, faire retour au silence pour, dans un second temps, aborder la réécoute.
Sur le terrain, on l’expérimente, on fait face à l’arrivée d’un sonore toujours hypothétique, choisissant une distance de prise, en toute ignorance de l’à-venir. Tout à l’inverse du photographe, qui s’appuie sur la fixité d’une présence permanente, au moins celle d’un décor, ou sur la présence avérée d’un objet en mouvement ; mais au son, qu’en est-il du savoir de ce qui va jaillir ? Quand ? Et où cela aurait-il lieu ? Personne ne le sait. Toujours « battus », au son on finit toujours « battu », débordé par l’imprévisible nature chaotique des évènements surgissant, en puissance ou en insignifiance. On se découvre soudain trop près ou trop loin, jamais dans l’idéal point de vue d’un attendu prévisible. Le son fait peu de cas de la prévision qui nous habite, de cet idéal attendu bâti sur la mémoire des expériences passées, le sonore se moque bien de l’idéalité d’une attente.
Face à ce « tout » recueilli par le micro, la réécoute nous offre l’amer constat de voir disparu ce que la vie sur site nous permettait librement de choisir. L’excédent domine ce qui a été recueilli : un trop d’information sans valeur et sans choix. Une saturation sonore de mouvements ramenés à une égalité de valeur de tous les sons. Difficulté d’y trouver sa respiration.
Comment revivre ce beau silence dans lequel régnait ce que nous écoutions ? Le splendide isolement de cette écoute toute engagée vers une seule chose en dépit de tout brouhaha ? Car l’écoute se constitue dans un tour à tour, une succession, jamais deux données perçues ensemble. L’attention peut y être coupée, même profondément engagée, elle vit dans les pointillés que les silences détachent. Comment oublier ces silences, établis en nous dans des retours vers notre mémoire, ceux que chaque surgissement instaure. Coupure par surgissement comme coupure du montage mettent côte à côte un avant et un après, une coupure encadrée de deux oublis, ce qui avait lieu n’est plus, tout comme ce qui a précédé ce plan nouveau venu. Le silence est partout, il domine et nous ne l’entendons plus tant nous sommes attentionnés à construire notre continuité. Si nous n’y prenons garde, « croyants » que nous sommes en une vérité des outils, nous acceptons, sans plus la voir, la saturation que l’automatisme de la capture opère à notre insu. Comment donc restaurer ces silences subjectifs, ces silences vitaux pour l’écoute, propres à celui qui va devoir « construire sa place » devant les images ? Seuls les silences peuvent aider à respirer, à sortir un peu de l’apnée infernale. Le silence n’est pas le rien, les blancs qui séparent les mots d’une scripta continua[1] sont ceux qui permettent autant de reprendre son souffle que de faire apparaître le sens de mots tout à coup détachés. Le silence est le point d’articulation moteur de la dynamique du récit. Il n’est pas l’établissement d’un rythme mais la condition de toute compréhension.
D’ordinaire, chacun oppose les silences aux bruits et les pense comme des trous, des vides, des absences, validant ainsi une considération référente aux bruits : il y a du bruit ou il n’y en a pas. Pourtant, si nous écoutons attentivement les silences, nous nous apercevons de la diversité des résiduelles et des petits bruits qui les habitent. Ni vide, ni plein, chaque silence, comme chaque bruit, est une bulle, une poche qui grandit en disparaissant et dont les infimes matérialités, les presque-riens inqualifiables, colorent la matière. La nature des silences change du proche au lointain. Silence de quel lieu, de quel événement, devrait-on demander ; et entendu depuis quelle place ?
Le son est une résiduelle turbulente prise dans un mouvement qui va en s’effaçant et c’est au lieu même de cette dilution dans l’air que le bruit fait silence.
Pour nous, faire silence est un acte engagé dans une relation à l’autre ou au monde – ce qui revient au même –, une relation qui ne peut être tenue qu’en intermittence ; c’est un acte signifiant qui peut vouloir dire « je te laisse la parole et t’écoute ». Là où le silence oblige, il faut répondre. Une parole appelle une réponse, il faut produire un son. Répondre au silence par le silence déclenche l’inquiétude : c’est un silence qui s’épaissit de sens, un silence trop éloquent, provocateur.
Dans tous les cas, faire silence préside à une attention portée. De même que pour écouter, il faut garder le silence pour observer ce qui advient ou pour comprendre ce qui a eu lieu.
Observer le champ sonore par ses silences, en considérant les vides plutôt que les pleins, peut donner le sentiment d’effectuer un renversement de l’acte d’écoute. Nous pouvons pourtant dire qu’il n’en est rien. En effet si, dans notre permanente volonté d’acquérir, nous valorisons ce que nous conquérons en faisant peu de cas de ce que nous abandonnons, à l’inverse, notre réalité physiologique ne répond aucunement à cela. Car, a contrario, notre économie est tournée vers la nécessité de désinflation : ne pas prendre, ne pas entendre, ne pas regarder, ne pas agir. Notre économie vitale veille pour sa survie à la limitation de ses dépenses. Voilà pourquoi nous nous contentons d’écouter ce que nous désirons, ce qui nous est utile, ce qui nous est strictement nécessaire et suffisant.
Daniel Deshays
1. Ou scriptura continua, l’écriture continue que les Grecs et les Romains utilisaient.