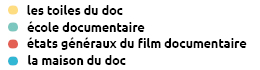2018
2018  Fragments d’une œuvre : Sandra Davis, Vivian Ostrovsky, Martine Rousset
Fragments d’une œuvre : Sandra Davis, Vivian Ostrovsky, Martine Rousset Fragments d’une œuvre : Sandra Davis, Vivian Ostrovsky, Martine Rousset
Nombre de mes œuvres ont trait au corps, que je considère comme le site des fondements visuels et dynamiques qui structurent les pulsions, les pensées et les sentiments humains. Je mets l’accent sur l’expérience du monde telle qu’elle est modelée par le fait de vivre dans un corps de femme. En dehors du corps lui-même, on trouve aussi dans mes films de nombreuses images de paysages naturels et de constructions architecturales. Ces œuvres, en tant que formes rythmiques reposant sur la durée, sont conçues pour être comprises par le corps et les sens, et pas seulement par l’esprit conceptuel. Mes méthodes de montage produisent des contrastes entre la figuration et des tempos lyriques obéissant à des rythmes à la métrique tranchante. Ainsi, un sens paradoxal peut émerger, et le sens tel qu’on l’imagine traditionnellement peut s’effondrer dans des flux d’images parallèles, animés d’une pulsation concomitante, jusqu’à ce que l’un domine l’autre, puis s’écroule et se reforme. J’ai employé pour ces films diverses techniques cinématographiques qui mettent en avant la nature lumineuse du matériau et du processus photographiques, ainsi que la texture de la pellicule.
Je m’inscris dans l’histoire du féminisme, de Simone de Beauvoir – qui a affirmé que l’on ne naît pas femme mais qu’on le devient, indiquant ainsi que l’identité et le genre sont des constructions – à des artistes comme la cinéaste Gunvor Nelson, dont les œuvres rendent compte des expériences psychologiques et corporelles les plus intimes des femmes.
Dans l’histoire du cinéma expérimental ou personnel (ces films réalisés par des artistes, conçus comme des œuvres d’art uniques plutôt que comme des productions commerciales) aux États-Unis, une certaine tendance cinématographique s’est développée : elle met au premier plan l’acte de voir avec l’œil de la caméra, considéré comme un équivalent direct de l’œil de l’artiste. Marie Menken et Stan Brakhage font partie de ses représentants les plus importants. Leur travail m’a beaucoup influencée. Après mes premiers films, parmi lesquels Maternal Filigree, qui cherche à convoquer par un flux d’images silencieuses des échos de la sexualité, de la naissance et de la maternité, je me suis concentrée sur la réalisation de films sonores, en cherchant à entrelacer le son et l’image ou à les faire se percuter. L’une des possibilités qui s’est ouverte à moi grâce au son était la mise en place de relations poétiques plus denses, mais le son était aussi la clé pour créer des œuvres qui souligneraient et évoqueraient une expérience à la fois tout à fait personnelle et collective.
Un film en 16 mm qui se déplace à la vitesse de vingt-quatre images par seconde marque l’œil et le cerveau d’une signification que la conscience du spectateur doit synthétiser pour en faire un tout à la fin du visionnage – et il n’est pas rare d’entendre des spectateurs dire qu’ils ont « vu » un film très différemment au gré de visionnages successifs. Tout au long de ma carrière, l’élaboration d’installations et d’œuvres plastiques créées à partir d’éléments, d’images et de thématiques tirés d’un film-source m’a permis de retravailler certaines images, de les recontextualiser (par exemple grâce à un processus de collage), d’isoler ou de tirer certains des nombreux fils qu’un film contient en puissance.
Dans A Preponderance of Evidence, j’ai exploré les thématiques de l’amour, du pouvoir, de la sexualité et de la violence à travers un mélange non narratif de plans filmés dans la nature, de vitraux de cathédrales européennes et d’images tirées de deux films réalisés dans les années cinquante. Le premier, produit par un organisme dédié à la santé mentale, tente de décrire les raisons pour lesquelles certains jeunes hommes tombent dans la délinquance ; l’autre aspire à guider les lycéens dans leur quête de cavalier/cavalière pour le bal de fin d’année. J’ai superposé ces documents aux témoignages de trois femmes évoquant leur vécu de la sexualité, des relations affectives, des avortements illégaux et de l’adolescence en tant que Juives dans la Russie révolutionnaire ou dans le Midwest protestant des États-Unis. Leurs anecdotes révèlent des problèmes à la fois personnels et intimes, mais symptomatiques de faits sociétaux ayant trait à la compassion et au pouvoir.
On peut voir deux tendances dans ma production cinématographique. D’un côté, des œuvres denses, de longue durée, qui cherchent à synthétiser divers matériaux audio, visuels et thématiques pour en tirer une œuvre audiovisuelle cohérente. De l’autre, des formes plus courtes, des odes, des sortes de petites histoires sans récit. J’emploie le mot « ode » dans le sens français d’un instant de rêverie qui, pour moi, exprime une passion pour un lieu. Une forme courte réalisée dans un état d’admiration, tentant de faire sentir une présence, se confrontant au temps et à la disparition des êtres. Les images de « lieux » sont importantes pour moi – les paysages, la terre et le sol (souvent en gros plan ou en très gros plan) –, tout comme les images d’eau, et les spécificités de ces différents éléments selon les saisons. Lorsque que je compose un film, je traite les différentes lignes de son et d’image comme des lignes de « voix » dans une œuvre chorale ou une pièce musicale polyphonique.
Sandra Davis
Ceci n’est pas une note d’intention puisque mes films ne sont pas le fruit d’une intention. Je filme des scènes du quotidien avec ma caméra Super 8, je les classe, les laisse mariner pendant un moment, puis j’en assemble certaines par thème – jamais chronologiquement. Mes films constituent une sorte de journal, souvent composé de notes de voyage car j’ai tendance à beaucoup vadrouiller.
J’ai commencé par la photo, très jeune. Ma mère étant photographe, je regardais dans son Rolleiflex et ça me plaisait. J’ai essayé de faire mes propres photos, sans trop de succès mais avec persévérance. Quelques années plus tard, quelqu’un m’a offert une caméra et, pendant longtemps, j’ai fait des home movies en 8 mm puis en Super 8. Ce n’est que beaucoup plus tard que j’ai commencé une vraie activité cinématographique. J’ai toujours aimé le cinéma ; ma mère nous y emmenait souvent. Je voyais pas mal de films sans jamais penser à en faire. C’est par l’autre côté que j’ai commencé, en organisant des festivals de films de femmes, dans les années soixante-dix.
Je ne trouvais pas normal que les films réalisés par des femmes ne soient pas distribués. Quand on a organisé le deuxième festival de films de femmes à Paris, on en a trouvé des quantités qui n’avaient pas de distributeur ni de chance d’être montrés alors qu’ils étaient, dans l’ensemble, très bons. J’ai vu là une occasion de me jeter dans l’action : j’ai organisé des festivals, puis je suis passée tout naturellement à la distribution, car une fois les festival finis, les femmes cinéastes n’avaient pas de lieu où déposer leurs copies pour qu’elles circulent.
J’ai commencé à distribuer des films réalisés par des femmes ou sur des femmes, à les apporter dans des festivals de films de femmes dans toute l’Europe avec une vieille Renault 4L déglinguée. Il y avait aussi des programmes consacrés au cinéma féminin dans de nombreux festivals, et je pense que c’était nécessaire. J’aimais le cinéma « expérimental », je trouvais qu’il y avait là une liberté unique. Mais « expérimental » n’est pas une très bonne appellation : je préfère dire qu’il s’agit de cinéma non narratif. Il s’agit d’une façon moins attendue d’exprimer quelque chose. J’y ai trouvé quelque chose d’imprévisible qui me manquait dans le cinéma mainstream commercial.
J’ai rencontré des cinéastes expérimentaux et, au bout d’un certain temps, Martine Rousset m’a incitée à monter mes images. Elle m’a montré comment faire. On était en Provence, dans la salle de bains d’un gîte rural, une pièce sombre creusée dans la roche. On a pris des ciseaux, de la colle, une colleuse, et ça a été mon initiation. J’ai tout de suite travaillé et l’image et le son. Je n’ai jamais conçu de film silencieux : j’essaie de jouer avec le son. Mes films passent dans les festivals, mais ils sont faits pour tout le monde.
J’ai commencé à monter en Super 8. L’étape suivante, ça a été de tout monter en 16 mm. C’est ainsi que je travaillais : je montais 80% des images moi-même, en Super 8, ensuite je gonflais le tout en 16 mm et j’affinais en 16 mm. Maintenant, je suis passée au montage virtuel car il n’est plus possible de continuer à monter à l’ancienne. Et puis, j’ai constaté dans plusieurs festivals que les projectionnistes ne savent plus projeter le 16 mm. Il faut en tenir compte. Je suis la première à le regretter, car j’aime beaucoup le 16 mm comme format et comme texture. Non seulement le Super 8 coûte vraiment cher mais il reste très peu d’endroits où le développer. La vidéo me paraît aseptisée. Le Super 8 est doux, flou et agréable. Ça me plaît toujours.
Vivian Ostrovsky
Le cinéma, l’empreinte argentique, n’est pas du code. Il a trait au mémoriel : l’empreinte d’un pas sur le sable, c’est quoi ? Un type est passé par là qui n’est plus là. Que veut dire l’image-empreinte ? La trace, une image d’absence et de présence. C’est un outil et un art de la physique du temps, le cinéma, vingt-quatre images seconde. Aucune question fétichiste, jamais. Ce qui est en en jeu, ce sont simplement des expérimentations de langage et de matérialités. Un art des matérialités des temps. Avant de dire expérimental. La vidéo, ce n’est pas ça. Il faut choisir ses outils en fonction de ce que l’on fait et trouver les sentiers sauvages et pauvres, tels pinceaux pour telle toile, et on les trouve toujours dans l’élémentaire. Si l’on veut faire une œuvre riche, il faut alors se compromettre jusqu’à l’os et pas venir pleurer.
Le terme « cinéma expérimental » ne convient pas et n’a jamais convenu. Il n’a aucun sens : tout art expérimente, sinon il n’est pas un art. Cela se rapprocherait de quelque chose comme un arte povera du cinéma. C’est une notion qui pose et qui ouvre plus clairement.
Pour moi, la nature d’empreinte de l’image argentique en fait une image inscriptive (qui est un mot qui n’existe pas mais je m’en fous), scripturale. Un film, c’est un écrit, en 16 mm tout particulièrement, qui a la stabilité de la page. Je ne dis pas un texte, n’est-ce pas, mais un écrit. Quelque chose qui est à lire dans un autre langage – comment l’entendre ? Quand l’argentique disparaît, l’écrit disparaît aussi, le corps disparaît, la mémoire disparaît, l’inconscient disparaît. Il reste quoi ? Cela fait partie de quelque chose de génocidaire.
J’ai tout de suite aussi aimé les images « élémentaires ». Ne pas vouloir lisser, sophistiquer, chercher à prendre le pouvoir sur les choses. J’ai toujours eu envie d’images élémentaires parce que cet élémentaire-là pouvait capter des choses plus qu’en dominant le cadre, etc. Ça ne m’a jamais trop intéressée, le travail du cadre, la maîtrise de la visée. Moi, ce qui m’intéresse, c’est la vision. La vision, c’est ce qui se passe entre toi, ta caméra et vers où tu es en train de chercher quelque chose.
Quand il y a film avec texte, c’est qu’il y a une rencontre entre un paysage et un texte. Non pas un paysage qui illustre un texte ou un texte qui va illustrer un paysage, mais un lien de similarité, comme si les racines du texte étaient dans ce paysage, comme si les racines du paysage étaient dans ce texte. Le cinéma peut essayer de voir ce que veut dire ce : « c’est là ». Quelle est la racine commune ? Est-ce que ce paysage précède ce texte ? Est-ce que ce texte existe parce que ce paysage existe dans le monde ? Comment ça se rencontre, comment passe le texte dans le paysage, comment le paysage passe dans ce texte ? C’est fragile ça, ce n’est pas là pour imposer des certitudes ou des analyses.
L’image que je filme, je ne la reconnais pas tout de suite. Je la filme, en général dix ou quinze fois : j’arpente, je reviens jusqu’à ce que quelque chose soit épuisé. Après, je développe, et si je peux développer moi-même, c’est très bien : en labo, développer, c’est ce que je préfère. Ensuite je la regarde et je dis : « C’est la merde, il n’y a rien. » Il n’y a jamais rien. Après, j’attends. Tu peux attendre deux jours, dix jours ou dix ans et au bout de deux jours, dix jours ou dix ans, tu as oublié et tu la re-regardes et là tu dis : « Ah, voilà ! » C’est là, tu la reconnais. Il y a eu cette première révélation dans le geste technique, chimique de voir monter l’image et après il y a la révélation qui doit se faire en toi de reconnaissance de cette image et de ce qu’elle te dit. Et ça, j’ai l’impression que ça se passe derrière mon dos, c’est une histoire d’inconscient, le temps d’une trajectoire mémorielle. Walter Benjamin en parle, en disant que le cinéma introduit dans l’image « l’inconscient visuel ». Et c’est par là que, chez moi, ça travaille. Et c’est pour ça que je mets du temps à reconnaître les images. Après, quand je les ai reconnues, je passe au montage, et ça va.
Je trie, je mets un ordre, j’agence déjà, je choisis les plans, ce qui fait qu’ensuite, au montage, je cherche surtout ce qui se passe entre l’image et le son et tente de les faire respirer l’ensemble. Des alchimies se produisent, avec toujours le sentiment extrêmement précis, aigu je dirais, que l’agencement est juste, ou pas. Avec en éveil tout le travail fait, je vais pas à pas au rythme de la machine. Ce n’est pas si compliqué que ça. Comme je n’ai pas de hantise de cadrage quand je filme, je n’ai pas de hantise de construction, de rythmique… Je suis juste aux aguets, mais je pense que la cohérence de mes films n’est pas donnée par le montage.
Il y a le déplacement de la jonction image-son, qui peut aller de la disjonction radicale à des navigations imprécises, en passant par du mutuel et des réciprocités – l’image et le son, c’est toujours réciproque, dirait l’autre –, mais le déplacement initial, c’est celui de l’image vers ce qu’elle est d’empreinte. Quand on l’affranchit de sa fonction de représentation, de narration, elle devient image-passage et passage du réel. Et le passage, c’est la vie, l’histoire, les autres, le vent dans les arbres, les racines qui s’accrochent à la terre…
Martine Rousset
Débats animés par Federico Rossin.
En présence de Sandra Davis, Vivian Ostrovsky et Martine Rousset.