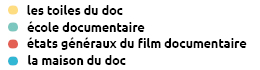2017
2017  Route du doc : Liban
Route du doc : Liban Route du doc : Liban
« Une maison aux nombreuses demeures » : ainsi l’historien Kamal Salibi décrit-il ce territoire d’une dizaine de milliers de kilomètres carrés aux nombreuses communautés et autant d’allégeances. L’histoire récente du Liban est aussi celle de toute une région, le Moyen-Orient. Terre d’accueil pour les peuples voisins, le Liban est aussi un lieu que l’on quitte. Les millions d’émigrants libanais de par le monde en attestent. Mais ce si petit pays n’est pas à un paradoxe près. Le conflit armé qui éclate en 1975 sera le début de multiples guerres, un imbroglio de forces internes et externes qui laissent le pays meurtri, informe.
En 1991 s’installe une trêve. Les seigneurs de la guerre (des guerres) sont aujourd’hui – sinon leurs descendants ou leurs subalternes – les garants de la paix civile. C’est sous le prétexte de cette paix si fragile que des films sont interdits par la censure, comme cela a été le cas pour En cette terre reposent les miens. Plus de vingt-cinq ans après la fin des conflits armés, il reste impossible de nommer les responsables, de décompter les disparus, de cartographier les fosses communes ou même de faire son mea culpa, de s’avouer bourreau ou victime, ou les deux à la fois. Aujourd’hui encore, les manuels d’Histoire éludent cet intervalle long de dix-sept années. Le cinéma, quant à lui, a pu trouver les formes pour raconter. Mais que dire au moment où a lieu la catastrophe ? Que filmer alors que s’abat une guerre ? Rien. Tout ce qui sera dit, tout ce qui sera filmé, le sera forcément dans l’après coup. Et si l’après n’arrivait pas ? Et si le Liban, sans cesse pris dans des poches de violences, n’était ni tout à fait en état de guerre, ni tout à fait en état de paix, perpétuellement dans l’entre-deux ? Sans doute les longues surimpressions dans (Posthume) de Ghassan Salhab – essai tourné dans l’après de l’agression israélienne en juillet 2006 – disent-elles si justement ce territoire qui sans cesse vacille entre dévastation et réparation.
C’est dans cette béance que prennent forme les œuvres documentaires proposées ici, des matières et des formes aussi différentes qu’exigeantes, avec en commun un besoin tenace d’inscrire le passé dans le présent. Et si « temps de guerre » et « temps de paix » n’ont de cesse de se confondre, les cinéastes proposent alors d’appréhender l’espace. Chaque œuvre, mettant en scène huis clos, pérégrinations urbaines ou métamorphoses du territoire, devient alors une tentative d’inscription de soi dans le monde, quand la mémoire et l’Histoire ne sont plus seulement affaire d’héritage mais (re)constructions du présent. Ainsi c’est dans un huis clos, reconstitution du bureau du président de l’époque, que des étudiants d’aujourd’hui jouent les rôles de ceux qui ont participé aux mouvements estudiantins à l’Université Américaine de Beyrouth en 1974. Plus au nord, dans la ville de Tripoli, dans une autre forme de huis clos, une jeune femme filme dans le cocon familial ce père qui ressemble tellement à Abdel Nasser, alors qu’elle sait déjà qu’elle va partir. Ailleurs, dans une sorte de non-lieu, devant un mur qui lui aussi fatigue, une mère prend la pose pour un ultime voyage immobile avec son fils cinéaste vers l’autre pays où il est né en 1958. C’est dans les espaces quotidiens aujourd’hui vides, peuplés de l’absence du père, qu’une autre mère est filmée. Sa voix nous parvient du passé, lettres audio sur de vieilles cassettes, et raconte les migrations contraintes d’une famille du Sud, qui sont celles de tout un pays. Encore au Sud, à Marjayoun, pour fouiller le passé d’un autre père absent, cette fois pour d’autres raisons – l’histoire innommable de ces hommes qui ont « collaboré » avec Israël. D’autres périples encore. Une épopée arménienne qui s’étale sur toute la région, les géographies disant dans leur état présent le passé ; un minutieux voyage dans les espaces publics du monde arabe où les monuments à l’effigie de figures politiques deviennent une éloquente interprétation de l’Histoire ; un dispositif singulier où des personnages, filmés à l’intérieur d’un fourgon de verre qui à la fois les isole et les fond dans la ville, sont des oiseaux de septembre qui tentent en vain de partir.
Certaines trajectoires sont plus intimes, comme celle d’un jeune cinéaste, dernier descendant de sa lignée. Les espaces du film se déploient comme autant de facettes d’une filiation possible ou impossible, d’une maison familiale au bord de la destruction à une échappée vers la montagne avec le père, jusqu’aux espaces les plus intimes, et où la mise à nu n’est pas seulement celle que l’on croit.
Le portrait de famille n’est pas, dans le documentaire libanais, une forme strictement narcissique mais plutôt un double constat d’amour et de ressentiment, de culpabilité et d’émancipation, d’individualité et de filiation, d’héritage et de transformation. Nombre de cinéastes libanais ont eu ce même geste : cherchant sans doute un sens quelconque à ce présent qui ne cesse de faire aveu de son impuissance, ils empoignent la caméra et la tournent vers l’intérieur. Ils se retrouvent alors face à des êtres désenchantés, mais porteurs de mémoire : leurs parents. Cette manifestation est trop récurrente pour ne pas être significative et elle traverse avec évidence notre programmation. Qu’il soit présent à l’image ou bien sujet absent, le visage d’un père ou d’une mère est aussi familier qu’il est mystérieux. Dans une partie du monde où les liens familiaux sont fortement sacralisés, le cinéma semble opérer un double mouvement de rapprochement et de recul, sans doute pour saisir la distance nécessaire face à cet amour quelquefois asphyxiant. Dans Diaries of a Flying Dog, un jeune trentenaire victime d’un trouble d’« anxiété généralisé » constate que celui-ci touche également son chien ! C’est une peur si paralysante qu’elle le pousse à en rechercher les causes jusque dans l’enfance, l’éducation, la guerre civile… Son ancienne institutrice suggère : « On demande aux enfants au-delà de leurs capacités. Cela apporte le sentiment de toujours échouer aux attentes. On lui demande toujours plus. Il n’en fait jamais assez. » Au réalisateur alors d’avouer : « Ils ne se sentent jamais avoir accompli quelque chose, le but ultime étant de libérer la Palestine ! »
« Certains ont l’âme élastique pour supporter la souffrance, d’autres sont perméables aux choses de la vie. » Ainsi la belle et perspicace dentiste décrit-elle son patient, le cinéaste disparu dans des conditions mystérieuses, Mohamed, et dont Mohamed Soueid dresse le portrait – ou s’agit-il là d’un autoportrait ? Pionnier de la vidéo au Liban, Soueid mène ses films à cheval entre l’investigation policière et la séance de psychothérapie, faisant du détournement la seule manière possible d’appréhender le monde, en tout cas de le filmer. Cinéphile, critique, auteur d’essais sur le cinéma et d’un roman, il signe de 1998 à 2002 une trilogie particulièrement jubilatoire, trois objets filmiques insolents et tristes : Tango of Yearning, Nightfall et Civil War. Ces œuvres sont trois facettes d’un même personnage ludique et désespéré : le cinéaste lui-même. Cousues main, elles exigent du spectateur de se laisser porter et d’accepter le risque de s’y perdre. Car c’est bien la perdition que filme Soueid avant toute chose, « une perdition encore vivante, palpitante malgré tout, bel et bien consciente du déclin des choses, et qui s’en enivre », écrit Ghassan Salhab à propos de Nightfall. « Soueid pratique le cinéma, et qu’importe si ici c’est de la vidéo, comme un art du montage et le montage comme un art de faire circuler les intensités. L’art de passer d’une couleur à une intonation de voix, d’un simple mouvement de caméra à une phrase musicale, de la naissance d’une émotion à la découverte d’un espace, d’une vitesse à une autre. Ce qui fait la suprême élégance de ce film, c’est cette exigence qui le pousse non pas à couper, mais à changer de ligne, à décaler, dès qu’une intensité menace de se localiser et de coller au spectateur. »
« Je suis entrée une nuit dans un jardin, pour sentir l’odeur des fleurs », chante la voix vacillante de la mère sur sa propre image silencieuse dans 1958. Vieilles chansons d’amour, hymnes patriotiques détournés, chants révolutionnaires, prières et incantations, chants scouts, poèmes solennellement déclamés autour d’un verre d’arak, ou gravement superposés à des images d’archives… La tradition orale n’est pas ici uniquement une question de rythmes, de musicalités, mais elle tisse les strates multiples qui viennent accompagner l’image, s’y entremêler, alors que la parole elle-même s’épuise, que le silence est chargé de trop de non-dits. Les chants et les poèmes traversent les documentaires libanais et sont avant tout matières, passages, tressages. Ils irriguent naturellement les films et permettent de tisser des liens. Mais ils sont aussi, et particulièrement chez Mohamed Soueid, des contre-pieds à la vie même.
Carine Doumit et Christophe Postic
Débats animés par Carine Doumit et Christophe Postic.
En présence de Chaghig Arzoumanian, Reine Mitri, Ghassan Salhab, Mohamed Soueid et Fadi Yeni Turk (sous réserve).
Avec le soutien de la Fondation Liban Cinema (Maya de Freige) et l’Institut français du Liban (Luciano Rispoli).
Remerciements particuliers à Myriam el Hajj (FLC).