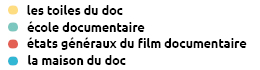2017
2017  Mémoires des territoires
Mémoires des territoires Mémoires des territoires
Dans Le Dépaysement, Jean-Christophe Bailly raconte comment, une nuit de 1978 ou 1979 à New York, il voit La Règle du jeu de Renoir à la télévision : ce n’est pas une découverte, mais une révélation, celle « d’une appartenance et d’une familiarité » que ce film « tellement français » charrie avec lui. C’est l’un des points de départ du voyage entrepris par l’écrivain à travers le territoire français, singulièrement dans ses espaces les moins commentés par les manuels d’histoire ou les guides touristiques. Ce voyage, en effet, est motivé par autre chose qu’une recension diligente des paysages remarquables, il inaugure une recherche qui s’attacherait à la mémoire des territoires – ce que Bailly appelle, lui, « une histoire des traces » – en tentant de retrouver dans l’écriture cette émotion, intime et commune en même temps, propre à un lieu. Mais le plus surprenant tient encore à la manière dont cette écriture est marquée par les impressions, au sens cinématographique du terme, que les territoires arpentés ont laissées sur le voyageur : il fait défiler dans sa mémoire les « rushes » de ses pérégrinations et procède par « travelling » et « fondus enchaînés » pour entraîner le lecteur dans ses pas. Nul doute que si l’écriture convoque ici ces métaphores cinématographiques, c’est parce que la mémoire fonctionne par impressions sensibles, images, couleurs, vibrations, pulsations. Cette mémoire des territoires détermine aussi le geste de cinéastes-voyageurs, marcheurs infatigables et filmeurs invétérés, dont la pratique se résout davantage dans l’écriture mobile et personnelle de la dérive filmée ou du cinévoyage que dans l’exploration systématique ou le repli d’un territoire sur des frontières et des identités. Leurs films cartographient des espaces délaissés à la périphérie des grands centres urbains, topographient les strates enfouies de l’histoire d’un paysage contemporain, et invitent surtout à des voyages dans le temps de la mémoire et de l’oubli. Au fil de deux journées de projections et d’échanges, l’atelier « Mémoires des territoires » réunira quelques-uns de ces cinéastes pour envisager la manière dont ils abordent des territoires proches ou lointains, ordinaires ou extraordinaires.
On s’intéressera le premier jour aux espaces urbains et péri-urbains marginalisés, laissés à l’abandon ou encore recouverts par de nouveaux aménagements qui tentent d’effacer les cicatrices de l’histoire. On opèrera par coupes transversales dans deux villes européennes : Berlin et Rome – la première, lieu obsessionnel du retour, où la mémoire achoppe sur l’effacement progressif des ruines ; la seconde, terrain d’expérimentation des dérives et périples du groupe d’artistes et d’urbanistes Stalker. En août 1945, Jean Rouch est à Berlin. Il a vingt-huit ans. Il n’est pas encore cinéaste mais ingénieur des ponts et chaussées et, à ce titre, envoyé en tant que lieutenant du génie avec une unité de déminage en Allemagne. Devant la ville en cendres, il conçoit le projet d’un film qu’il ne réalisera que trente-trois ans plus tard. Laurent Pellé, délégué général du festival international Jean Rouch, prépare aujourd’hui avec l’écrivain et acteur allemand Hanns Zischler, qui accompagnait Rouch à Berlin en 1988, un ouvrage sur la naissance de Rouch cinéaste à partir de l’expérience fondatrice de ce film et de son tournage différé. Il en évoquera pour nous la genèse et la place dans l’œuvre du cinéaste retourné à Berlin trente-trois ans après la fin de la guerre pour filmer une ville qui n’a de cesse d’enfouir le passé. Retour à Berlin est aussi le titre d’un livre très personnel de l’historien de l’art Jean-Michel Palmier, qui n’a cessé de recenser les traces et vestiges pour fixer dans sa mémoire le souvenir de cette ville défigurée, avec ses immeubles éventrés qui avaient conservé dans la poussière et les gravats le mobilier et les journaux du jour de leur bombardement. Cet essai sur la mélancolie des ruines a inspiré au cinéaste Arnaud Lambert une sorte de portrait croisé de la ville aujourd’hui et de l’historien disparu. Si on entre dans la ville par le train, comme autrefois dans le Berlin, symphonie d’une grand ville de Walter Ruttmann (1927), la forme de cet essai documentaire est plus proche de la sonate que de la symphonie urbaine. C’est une nocturne mélancolique qui accompagne le retour obsessionnel de l’écrivain dans les ruines progressivement recouvertes par la ville.
Le collectif Stalker, fondé à Rome au milieu des années quatre-vingt-dix, s’est donné pour ambition de faire surgir « l’inconscient profond des villes », en arpentant les espaces à la marge, la périphérie urbaine, ces « lieux de la mémoire réprimée » comme il les appellent aussi. Stalker, qui emprunte son nom au film magistral d’Andreï Tarkovski, est une entité nomade et un « “activateur” d’espace ; son registre d’intervention est la performance, son lieu d’exécution le territoire, son mode de visibilité l’image – cartographique, photographique ou filmique [1] ». Gilles Tiberghien décrit ainsi le collectif qui invente de nouvelles manières d’appréhender le territoire urbain, à travers ses zones interstitielles et ses voies de traverse. Leur démarche peut être apparentée à la dérive situationniste ; elle est néanmoins plus expérimentale et plus militante, et ce n’est pas par hasard qu’elle rencontre celle d’une cinéaste française dont le travail rapporte le mouvement des images à celui des corps. Aude Fourel filme comme elle marche et marche comme elle filme. Sa rencontre avec Stalker a d’abord donné lieu à des marches collectives à la périphérie de Rome, puis entre Rome et Saint-Etienne. De ces déambulations, Aude Fourel a impressionné ses images Super 8, en superposant aux plans d’une ville défamiliarisée les voix des personnages de Pasolini, Fellini et Duras dans leurs films romains. À travers Rome défait les chronologies et les points de repère dans une dérive qui explore les confins de la ville et éprouve le vertige de l’errance. Ces traversées ont mené la cinéaste vers les récits de clandestinité et d’exil d’anciens militants du FLN, entre l’Algérie, l’Italie et la France, récits qui forment la trame d’un film en cours de réalisation, et que nous évoquerons pour clore le voyage de cette première journée.
Le deuxième jour s’attachera à ce que l’on pourrait appeler avec le cinéaste Pierre-Yves Vandeweerd des « territoire[s] perdu[s] », abandonnés par des peuples poussés à l’exil par la guerre ou l’effondrement du bloc soviétique. De ces déserts des tartares et de ces pays sans nom, on entreprendra l’exploration avec deux cinéastes qui cherchent à saisir la vibration discrète de ces paysages au rythme de leurs marches filmées : Pierre-Yves Vandeweerd et Christian Barani, dont le travail articule toujours plus étroitement une archéologie de la mémoire et une cartographie sensible des territoires. Le premier parcourt des lieux qui sont comme des hors-champs de l’histoire : le Sahara occidental et ses déracinés forment la trame d’une trilogie – Le Cercle des Noyés (2007), Les Dormants (2009) et Territoire perdu (2011) – où s’est inventé un geste cinématographique débordant l’état des lieux géopolitique pour établir une forme poétique, un territoire de cinéma. C’est avec Les Tourmentes (2014) et les tempêtes psycho-climatiques des monts de Lozère que cette forme a pris une tournure plus expérimentale encore, avant que Les Éternels (2017) n’éprouve cette mélancolie de l’errance dans les paysages du Haut-Karabagh. La caméra-marchée est l’outil fondamental de cette exploration des confins de l’histoire et du monde. Chez Christian Barani, cinéaste venu de l’art vidéo, elle est l’acte performatif du film, celui qui donne « corps » à l’image. Le tourné-monté des errances urbaines ou le montage syncopé au gré des fragments du réel qui accrochent le regard du cinéaste déplient l’expérience de perception propre à ces films marchés. Des townships de Windhoek, en Namibie, aux fantasmagories urbaines d’Astana, cité dystopique d’un Kazakhstan post-soviétique, les ciné-voyages de Christian Barani, dans l’hétérogénéité de leurs montages, éprouvent la fragmentation des mémoires et la non-congruence de celles-ci et des récits historiques. Partant des premières réalisations du cinéaste, nous évoquerons avec lui la genèse de ces formes filmiques et leur élaboration au fil d’une œuvre qui s’est construite dans des contextes géographiques et politiques extrêmement divers, mais n’a cessé pour autant de tresser des formes communes (la trilogie du Kazakhstan) ou sérielles (les dérives urbaines), cherchant dans la reprise et la variation à performer la mémoire des territoires.
Pour poursuivre les réflexions initiées lors de ces deux journées de l’atelier « Mémoires des territoires », les participants sont invités à rejoindre l’atelier « Territoires de la mémoire ».
Alice Leroy
1. Gilles A. Tiberghien, « La vraie légende de Stalker », Vacarme, 28, été 2004, pp. 94-99.
Atelier animé par Alice Leroy.
En présence de Christian Barani, Aude Fourel, Arnaud Lambert, Laurent Pellé et Pierre-Yves Vandeweerd.