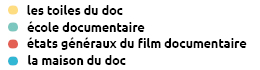2017
2017  Territoires de la mémoire
Territoires de la mémoire Territoires de la mémoire
Trois cinéastes, trois gestes de remémoration plutôt que de commémoration de territoires marqués par « l’Histoire avec sa grande hache » : en miroir de l’atelier « Mémoires des territoires », l’atelier « Territoires de la mémoire » invite Ruth Beckermann, Sergueï Loznitsa et Susana de Sousa Dias, dont les films récents marquent l’aboutissement d’une recherche au long cours sur l’écriture de l’histoire à travers les voix de la littérature, la matière des archives, la parole des témoins, et l’exhumation des traces du passé dans les paysages actuels. C’est un travail de « restauration » de la mémoire auquel se livrent, à différentes échelles et avec des outils qui leur sont propres, ces trois cinéastes ; un geste consistant à creuser dans les strates temporelles des territoires, à sonder les béances de l’histoire, à reconstruire des ponts, même fragiles, entre passé et présent de façon à faire coexister des temps hétérogènes et apparemment inconciliables : ceux de la mémoire et de l’oubli.
« Entre notre aujourd’hui, notre hier et notre avant-hier, tous les ponts ont été coupés », écrivait Stefan Zweig au début du Monde d’hier. Toute l’œuvre de Ruth Beckermann consiste en une tentative de reconstruction de ces ponts : elle appartient à une génération d’artistes et d’écrivains juifs viennois qui ont mis en œuvre une réflexion sur leur identité dans un contexte où le passé nazi de l’Autriche faisait brutalement retour sur la scène politique. Elle est la fille de survivants de la Shoah – son père a grandi en Bucovine, à Czernowitz – revenus vivre à Vienne après la guerre, une ville qui hante ses films et ses écrits, point focal et point de fuite de son œuvre, espace d’une mémoire en butte aux amnésies de l’histoire qu’elle n’a cessé de cartographier. Pont de papier (1987) apparaît de la sorte comme une réponse différée au désespoir de Zweig et comme la pièce centrale d’une trilogie de la mémoire, avec d’une part Retour à Vienne (1983) et de l’autre Vers Jérusalem (1990). Cette collecte des traces et des récits montre « combien la mort de nos proches est liée à la peur de l’oubli et, réciproquement, la peur de l’oubli est liée à la mort de toute une génération », observe Beckermann en voix off. Il faut avoir à l’esprit que ce rapport de la mémoire à l’oubli se double d’une tension permanente entre l’histoire et le présent : en arrière-plan de Pont de papier se déroule la campagne pour l’élection présidentielle qui voit éclater le scandale autour du candidat Kurt Waldheim, finalement élu, dont les compromissions anciennes avec le régime nazi refont surface. Les résurgences du passé dans le présent du film ne contribuent pas à un fatalisme qui verrait là une tragédie de la répétition infaillible de l’histoire : elles éclairent au contraire la trame complexe de la mémoire et de son inscription dans le présent. Dans son dernier film, la cinéaste a entrepris de porter à l’écran la correspondance des poètes Paul Celan et Ingeborg Bachmann. Die Geträumten emprunte son titre à l’une des lettres de Bachmann et suggère la possibilité pour le film de créer l’espace tangible d’une rencontre, entre les amants séparés aussi bien qu’entre eux et nous. Mais il fonde surtout une communauté des rêvés et de ceux qui n’appartiennent à nul lieu (unzugehörig), au sein de laquelle Beckermann a elle aussi sa place. Les motifs du voyage et de l’errance composent en effet une matrice particulièrement éclairante de son œuvre, entendus comme déplacement (donc comme sentiment de ne jamais appartenir au territoire où l’on vit) et comme quête de son identité et de sa mémoire [1].
Chez Sergueï Loznitsa, que les États généraux du film documentaire accompagnent depuis ses premiers films, le territoire de la mémoire appartient à la dissonance des temps qui sonde la fêlure du présent. L’archive est l’outil premier, parce qu’aussi le plus évident, de cette archéologie des images de l’oubli de l’histoire. Mais jamais elle n’est traitée comme un document du passé, un témoignage sans médiation : c’est au présent qu’elle opère dans un montage qui en actualise les résonances. À ce jeu d’orchestration des temps, la partition sonore prend une part décisive, elle qui confère aux images un caractère sensible en n’étant jamais dans une synchronie immédiate avec elles. Mais la mémoire affleure aussi dans les images « au présent », en particulier celles des deux derniers documentaires de Loznitsa, The Old Jewish Cemetery (2014) et Austerlitz (2016). Comme l’observe très justement Arnaud Hée, « ces deux films sont unis par le fait qu’ils prennent place dans des lieux de mémoire où, précisément et paradoxalement, la mémoire est empêchée [1] » : l’ensevelissement des pierres tombales du vieux cimetière juif d’une part, la transformation des ruines du camp en attraction touristique investie par des masses aveugles qui ne cessent pourtant de photographier leur présence en ces lieux d’autre part, voilà les formes de l’oubli que la caméra de Loznitsa rencontre pour leur opposer, à travers la composition des cadres et la fixité des plans, le travail du son et le flux du montage, une forme de remémoration qui laisse parfois affleurer au creux d’une image, la présence des spectres. Dans L’Esprit du cinéma, Béla Balázs ne décrit-il pas avec une prémonition troublante le geste du cinéaste quand il distingue le poète du reporter d’images ? « Le seul reportage des choses tangibles est insuffisant pour les organiser. Car il faudra parfois la sensibilité et la force des images du poète pour recréer l’atmosphère insaisissable de la réalité. »
Susana de Sousa Dias clôt avec Luz Obscura un cycle sur la mémoire des opposants au régime de Salazar au Portugal. Dans les archives photographiques à partir desquelles la cinéaste a entrepris un travail qu’elle appelle, avec l’historien Enzo Traverso, une histoire des « mémoires faibles », les visages des femmes et des hommes torturés et assassinés par la police politique de la dictature nous regardent. Leurs mémoires dessinent le contre-champ des « mémoires fortes » qui écrivent l’histoire. Inauguré avec Nature morte. Visages d’une dictature (2005), et poursuivi avec 48 (2009), cet ensemble de films redonne une voix aux détenus politiques à travers une série de témoignages directs ou indirects de victimes du régime superposés à leur portrait ou à celui de leurs proches. Dans Luz Obscura (2017), ce sont les voix de trois enfants qui, au présent, tiennent une chronique biographique à partir des photographies de famille prises dans la cour de la prison où leurs parents étaient incarcérés. À l’iconographie de l’infamie propre aux clichés anthropométriques, la cinéaste substitue la singularité des souvenirs et des biographies. C’est la mémoire des morts qui surgit dans la parole des fils et des filles, cette mémoire qui n’a pas d’autre lieu d’expression que la parole des témoins. Le présent de l’énonciation conjugué avec l’archive creuse une faille dans la ligne du temps, au moyen d’un montage qui repose avant tout sur le vertige de la mémoire, paradoxe qui noue à l’intimité des récits familiaux la violence redoublée de la disparition des morts, deux fois tués par la dictature et par l’oubli.
Alice Leroy
1. L’intégralité de cette analyse de l’oeuvre de Ruth Beckermann est publiée dans le numéro 14 de la revue Hippocampe : « Celan, Bachmann, Beckermann. Correspondance des rêvés » (juin 2017).
2. Arnaud Hée, « La caméra à remonter (dans) le temps », Images documentaires, n°88/89, juillet 2017, p. 45.
Atelier animé par Alice Leroy.
En présence de Ruth Beckermann, Susana de Sousa Dias et Sergueï Loznitsa (sous réserve).