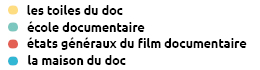2016
2016  Bataille des images
Bataille des images Bataille des images
Atelier 2
La mort en nos écrans
Après Al-Qaïda qui le faisait occasionnellement, Daech, dans ses premières années de domination, a multiplié les assassinats filmés. Parfois truqués, souvent non. Daech fait accompagner ses tueurs par des filmeurs. Drôle de couple. Le cinéma a presque toujours filmé la mort en fiction, comme une fiction, comme s’il ne fallait pas qu’elle soit « vraie » et qu’il faille en conjurer, toujours, la menace. Les spectateurs ont su très tôt dans l’histoire du cinéma que les « morts » (par exemple dans L’Assassinat du duc de Guise, 1908) ne l’étaient que le temps de la prise de vue, qu’ils pouvaient se relever pour une deuxième prise, etc. Montrée sur un écran, la mort n’est pas crue « réelle ». Pourquoi ? Parce qu’il y a des spectateurs, puis d’autres qui verront la même chose ; qu’il y a une autre séance, une autre encore... Par nécessité répétitive, le cinéma fait revenir les morts filmées autant de fois qu’il y a séance ; il ôte par là à la mort filmée le caractère d’un « réel » qui surviendrait une fois pour toutes.
Les films de propagande produits pendant l’une et l’autre des deux guerres mondiales ne pouvaient éviter de filmer de « vrais morts » et non pas des figurants, mais après que la mort leur ait été donnée ; et souvent les opérateurs poussaient les cadavres hors du champ. Les photos et les plus rares prises de vues de cadavres et de corps suppliciés ont servi pendant les guerres coloniales la propagande des colonisateurs. Il s’agissait non point de faire peur mais de faire comprendre que, mort pour mort, justice était rendue. Le système cinématographique reprend et réplique la fiction majeure des religions : qu’il y a toujours vie, fût-ce après la mort. La « résurrection » est devenue une mécanique.
Les petits « clips » de Daech sont difficiles à regarder. Il faut se laisser aller à une certaine perversion du désir de voir pour désirer subir ces images atroces. C’est ce que saint Augustin appelait « la concupiscence des yeux ». Mais voir et filmer sont deux choses bien différentes. Filmer, c’est d’abord enregistrer ce que l’on voit, c’est donc ensuite voir ce qui est enregistré. La logique mécanique du cinéma, la technique, n’ont pas été mis au point pour enregistrer l’inanimé. Le mouvement de la bande filmée porte en lui une équivalence entre vie et mouvement. Mettre fin à la vie, c’est aussi provoquer une sorte d’arrêt sur image. Je suppose, et nous nous interrogerons à ce propos, une certaine antipathie du cinéma à filmer le passage de vie à trépas, bien que le cinéma soit, selon le mot de Cocteau, « la mort au travail ». Car le cinéma filme en effet l’usure des corps et des choses, les destructions et les ravages, mais il a toujours préféré une « fausse » mort à la vraie. Les cadavres sont au cinéma le plus souvent des faux cadavres, maquillés pour ressembler aux vrais, les balles font couler la couleur sang mais ne tuent pas, etc.
Avec Daech, un autre monde commence, et il commence par des sacrifices sanglants qui ne sont pas simulés. Il est troublant de constater que dans le même temps, depuis quelques années, les cadavres envahissent les écrans des télévisions ou des ordinateurs : toutes les catastrophes, naturelles ou non, ont été filmées par des millions de petites caméras numériques et de téléphones portables, et ces images ont été diffusées.
La mort de tout temps a occupé l’esprit des êtres parlants, mais jamais à travers tant d’images. Il y a donc une familiarité nouvelle entre image et mort, et les filmeurs de Daech en jouent à la manière dont les films d’action hollywoodiens le font, avec effets spéciaux, sons et lumières, dans l’artificialité la plus grande. L’image s’est mise au service de la pulsion de mort.
Comment comprendre que l’on mette le geste cinématographique premier — prendre des vues et les enregistrer — au service d’une mise à mort des corps filmés ? Toute la machine cinématographique a été conçue pour filmer le vivant. Le Cinématographe Lumière est accueilli à sa naissance comme un dépassement de la mort : les corps filmés meurent, mais leurs images survivent. Filmer l’autre revient à ne pas le tuer. À le faire entrer dans la boucle d’humanité dont le cinéma est un anneau. Une nouvelle alliance vient donc de se nouer entre mort et cinéma, et cette alliance, pour moi comme contre nature, signifie la fin de tout espoir pour le spectateur. Ceux qui sont fusillés, qui explosent, qui sont égorgés disparaissent sans retour : de ce que leur vie aura été, ne sera donnée à voir que la mort. À la violence de l’exécution mortelle s’ajoute la violence de la prise de vue et de la diffusion mondiale de ces images de mort. Tuer/enregistrer/montrer. Il faut qu’en images la mort circule pour répandre à travers le monde des images de cadavres laissés sans linceul. Filmée, la mort se glorifie elle-même. Il s’agit bien de faire régner la plus grande terreur.
Jean-Louis Comolli
Les vidéos de Daech nous propulsent dans une ère nouvelle de propagande : elles s’appuient sur les habitudes plus ou moins voyeuristes du téléspectateur contemporain ; elles empruntent les modes de navigation de l’internaute sur les réseaux sociaux ; elles revisitent les blockbusters américains, etc. C’est pourquoi la propagande de Daech ne pourra pas ne pas solliciter en retour les œuvres cinématographiques et audiovisuelles qui lui servent de sources formelles. Il est sans doute trop tôt pour se prononcer, et il ne s’agit pas de faire des pronostics sur les films qui sauront prendre la mesure de cette connexion si singulière entre réalité et fiction dans les vidéos du groupe « État islamique ». Signalons trois caractéristiques globales de ces vidéos qui rencontrent de près notre « civilisation de l’image », et que le cinéma devra affronter s’il veut préserver son potentiel de dénonciation. La première d’entre elles est technique, et elle a trait à la démultiplication des supports d’images, inséparable d’un flot visuel et sonore quantitativement sans précédent rendu possible par les dispositifs de la Toile. À cet égard, le développement réticulaire des images de propagande n’est pas sans écho avec l’expansion diffractée des soldats de Daech sur le terrain. De même, il n’est pas exagéré de dire que la facilité de certaines conquêtes urbaines n’est pas sans évoquer, en termes de sentiment induit, la fluidité de la navigation sur internet.
La seconde caractéristique est presque ontologique, au sens où elle questionne les modalités d’enregistrement du réel par les moyens du numérique, tout en générant ce que Jacques Rancière appelle une « dé-hiérarchisation des types d’images » : « du public et du privé, de l’art et de la circulation des informations et des messages (1) ». Le versant négatif de cette « dé-hiérarchisation » est simple à formuler : il réside dans une confusion permanente des sources d’images, ce qui n’est pas sans relation avec le nihilisme raisonné entretenu par Daech. Si l’image doit avoir pour ses dirigeants une efficacité maximale, il faut simultanément que cette image soit sans reste, que rien ne lui résiste, et surtout pas un fragment de réel qui gripperait le transfert d’un message de propagande. D’où ce nivellement des niveaux de signification dans certains montages. Pour exemple, certaines vidéos du groupe extrémiste reprennent parfois sans vergogne les images amateurs des soulèvements arabes de l’année 2011, en faisant croire que les cris « Allahou Akbar », entendus quelquefois dans les premières manifestations en Syrie, étaient en réalité les signes précurseurs de la venue du calife.
La troisième caractéristique des manières de filmer de l’organisation « État islamique » concerne son esthétique, et elle rencontre là aussi un trait symptomatique de l’époque : ce que Sylvie Lindeperg appelle de nos jours une « esthétique du trop-plein ou de l’hypervisibilité (2) ». S’il existe un effroi provoqué par les vidéos de Daech, c’est parce qu’elles élèvent cette visibilité à un degré jamais atteint à ce niveau de diffusion : les décapitations, les assassinats de masse, les représentations de prisonniers brûlés vifs, etc. sont non seulement captées par les opérateurs de l’organisation, mais elles possèdent en outre de nombreux fétichistes de l’horreur qui les archivent dans leur ordinateur, y trouvant un « stimulant » morbide pour des vies devenues moribondes. Comme si le constat d’Ivan Illich, l’auteur de Némésis médicale en 1975, s’actualisait sous nos yeux : « Il faut des stimulants de plus en plus puissants aux gens qui vivent dans une société anesthésiée pour avoir l’impression qu’ils sont vivants (3). » Cette esthétique du tout-visible alimente de surcroît l’illusion d’une immersion dans l’action. Comment ? Essentiellement en multipliant les points de vue sur une même action. La diversité des points de vue peut aussi donner le privilège d’une perception augmentée d’une scène de destruction, comme celle du site archéologique de Nimrud survenue en mars 2015. Cette séquence saisissante s’achève avec l’enchaînement de trois plans fixes de l’instant où les djihadistes font exploser la cité assyrienne dans sa totalité : un choc visuel amplifié par une image rendue presque abstraite en raison de la poussière issue de l’explosion qui gagne subitement la totalité du cadre. L’hypervisibilité paraît alors se retourner en son contraire, même si cette image qui tend à l’abstraction nous confronte littéralement à une désespérante réalité : il n’y a rien à voir du site de Nimrud tout simplement parce qu’il ne reste plus rien de ce site.
Dork Zabunyan
Extrait de « L’État de propagande et le cinéma qui vient », Trafic, n° 94, été 2015.
1. J. Rancière, La Méthode de l’égalité, entretien avec L. Jeanpierre et D. Zabunyan, Bayard, 2012, p. 247.
2. Voir S. Lindeperg, La Voie des images, Verdier, 2013, p. 18.
3. Cité par P. Ardenne dans son ouvrage Extrême – Esthétique de la limite dépassée, Flammarion, 2006, p. 21.
Le Coran n’interdit nullement les images. L’islam n’est pas iconoclaste mais aniconique dans le sens où, pendant certaines périodes, des courants – essentiellement sunnites – évitaient la représentation picturale de la création divine, mais ne détruisaient pas les images par la violence, comme le souligne le grand historien de l’art islamique Oleg Grabar.
C’est principalement aujourd’hui avec la barbarie de Daech – pas uniquement envers les hommes mais aussi envers les racines de sa propre culture arabo-islamique, comme la destruction de la ville arabe pré-islamique de Hatra ou de Ninive, la Sumérienne – que réapparaît l’impression que les musulmans rejettent les images. Pourtant, cette barbarie n’a rien à voir avec la culture de l’islam. Si des musulmans se sont parfois éloignés de la représentation figurative, c’est pour d’autres raisons qu’une interdiction par le livre saint. Les premières générations de croyants ne voulaient pas se rendre coupables d’idolâtrie. Le prophète Mohammed n’avait-il pas en 630 détruit toutes les statues et idoles de la Kaaba à La Mecque, le saint des saints de l’islam ? Les musulmans voulaient aussi se démarquer du christianisme, qui était encore dominant dans la plupart des régions conquises, comme la Syrie et l’Égypte, et qui débattit également longtemps des images, jusqu’à ce que Jean Damascène gagne la guerre des icônes. Père de l’Église, fin connaisseur de l’islam, ministre d’un calife, il a probablement lui-même essayé de distinguer la chrétienté de l’islam, voire du judaïsme, et a ainsi permis à l’Église de faire du visuel son instrument principal de communication.
La recherche d’alternatives à la représentation figurative dans l’islam sunnite n’indique absolument pas que les musulmans n’ont pas créé des images. Après des expérimentations avec des motifs végétaux, et surtout floraux, comme représentations du paradis, comme les magnifiques fresques et mosaïques dans la grande mosquée des Omeyyades à Damas, une recherche vers encore plus d’abstraction sur des formes géométriques complexes est entamée. Il naît ainsi un art et une culture singuliers dans le Dar al-Islam, la maison de l’islam, qui, d’un côté, donne de la cohérence et un sentiment d’appartenance à une même civilisation sur les vastes terres de l’islam, mais qui reflète aussi une très grande ouverture vers d’autres cultures, notamment byzantine, perse et indienne. En témoignent les trésors architecturaux de Grenade, Fez, Kairouan, Le Caire, Jérusalem, Damas, Samara ou encore Herat ou Agra, pour ne citer que quelques exemples. Mais ce n’est pas uniquement l’architecture qui donne à l’art et la culture islamique leur essor. Des objets décoratifs d’une finesse rare y contribuent également, tout comme les sciences et la calligraphie et, surtout, la grande littérature et la poésie arabe ou perse. Des œuvres magistralement illustrées comme le recueil de fables Kalila et Dimna, le Makamat de Hariri et Les Mille et Une Nuits attestent que la réticence vis-à-vis du figuratif était loin d’être généralisée. L’art islamique a été, suite aux croisades, une inspiration décisive pour l’art européen.
L’arrivée des colonisateurs occidentaux au dix-neuvième siècle modifie à son tour le rapport à l’image dans le monde musulman avec l’introduction de la peinture moderne figurative. Des artistes arabes expérimentent alors et contribuent au discours moderniste, en négociant leur identité à la rencontre de l’Occident. Entre les portraits du Beyrouth ottoman et le surréalisme égyptien des années trente, les pratiques témoignent des interprétations diverses des modernités multiples. En parallèle, une tradition de cinéma émerge, surtout avec le cinéma égyptien et « Hollywood sur Nil », dont les Arabes raffolent. Les arts visuels jouent un rôle primordial dans la construction des discours nationaux et contribuent à l’émergence d’une identité culturelle panarabe.
Aujourd’hui les chaînes satellitaires et le Web 2.0 submergent le monde musulman, comme le reste du globe, avec des informations visuelles. Des images creuses et plates qui noient les mots et qui ne communiquent rien des réalités profondes du monde arabo-musulman. Pire, les médias rediffusent les images atroces des djihadistes. Pourtant, le monde arabo-musulman produit une multitude d’autres images profondes, dont l’acte de création est, comme le définit Gilles Deleuze, un acte de résistance contre la mort, par extension une mort culturelle, mais aussi contre les images réductrices de l’actualité sélective ainsi que contre le cauchemar propagandiste destructeur d’Al-Qaïda, Daech, Boko Haram, etc.
Asiem El Difraoui
Extrait de « L’image, contre-récit de l’islam » de Asiem El Difraoui et Antonia Blau, tribune dans Libération, 16 août 2015.
L’attention légitime portée à la violence et à l’efficacité des programmes de communication audiovisuelle diffusés par les propagandistes de l’État islamique ne peut que rendre impérative la nécessité de penser ce que fait et ce que peut le cinéma dans sa relation à la violence et à la mort. Filmer est un geste de plus en plus banal et mondialisé. En quelques décennies, la multiplication des écrans et la numérisation ont entraîné une transformation de la relation de tout spectacle avec les spectateurs. Donner forme aux images pour donner sa chance à la pensée, c’est-à-dire transformer le regard pour créer de nouveaux récits, faire surgir du possible, voilà ce qui doit rester l’affaire du cinéma. Le questionnement ici est double puisqu’il s’agit de réfléchir à la fois aux choix des formes visuelles concernant les violences exercées et les violences subies, et à l’exercice de la violence propre aux gestes cinématographiques. Ce sont là deux questions politiques : l’une concerne les images de la terreur et du pire, l’autre concerne l’action cinématographique sous l’angle du terrorisme dans des gestes révolutionnaires.
Dans la propagande diffusée par les meurtriers, véritables techniciens de la mise en scène du pire, les stratégies de communication professionnalisées relèvent d’un même modèle télévisuel. Désormais, la gestion pulsionnelle de la communication iconique et narrative n’est autre que celle des passions haineuses étayées elles-mêmes sur des idéalisations meurtrières. On oublie trop souvent qu’il n’y a de terreur qu’au prix de l’idéal et qu’il n’y a d’idéal qu’au prix de la terreur. La guerre entre des cultures soi-disant inconciliables se déploie dans la double conviction des ennemis d’être chacun les détenteurs de la vérité et du sens de l’histoire de l’humanité. Il appartient aux cinéastes d’analyser ces images pour révoquer toute fascination et tout effroi. Derrière ces crimes, n’oublions pas, comme le rappelle Serge Daney qu’il y a une longue histoire des peuples « sans visage ». Et Jean-Louis Comolli plaida toujours pour rendre sa dignité au corps que l’on combat. C’est pourquoi je souhaite faire un pas de côté pour considérer l’engagement politique dans la création cinématographique. Ces questions ne sont absolument pas nouvelles, elles ont une histoire violente pendant tout le vingtième siècle. Elles se posent aujourd’hui dans les termes que les nouvelles technologies et les réseaux sociaux redistribuent. Daech est un cas parmi d’autres qui disparaîtra pour laisser place à de nouvelles stratégies face auxquelles il faudra encore que le monde de la pensée et de la création trouve des réponses, invente les formes de la liberté. Castoriadis avait déjà désigné la nature mondiale de la barbarie qui n’est pas le fait d’un seul camp.
Dès les années soixante le Moyen-Orient a hanté les penseurs du cinéma pour de fortes raisons : critique du colonialisme, soutien dans les luttes pour l’indépendance, bataille menée contre l’impérialisme médiatique des États-Unis… Régner par la peur, cultiver la terreur, ruser avec la jouissance sont une vieille affaire, je l’appelle phobocratie. Daech a des maîtres et je ne pense pas que Daech dépasse ses maîtres. Serge Daney formula avec une acuité sans appel le régime spéculaire des industries spectaculaires qui exercent d’est en ouest la dictature visuelle du pire. Il écrit, quand Bagdad est sous les bombes : « Terrorisme iconique : au manque de visage de l’autre répond désormais l’exhibition par l’autre du nôtre défiguré. » L’État islamique est le partenaire intégré et sauvagement logique du néolibéralisme. Il mène une guerre impérialiste et médiatique. Quel visage le cinéma en tant que geste libre peut-il recomposer ? Je propose de reprendre le problème à l’époque où Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville produisent Ici et Ailleurs, au moment où Masao Adachi engage sa caméra dans l’Armée Rouge japonaise au côté des combattants palestiniens. Aujourd’hui le cinéaste Éric Baudelaire prend la relève de Masao Adachi pour penser avec lui et filmer sans lui à Beyrouth les protagonistes du conflit syrien. Là, dans l’enchevêtrement complexe du documentaire et de la fiction, un autre visage du Moyen-Orient, désorienté, douloureux et violent, s’indique pour un cinéma qui, sans éviter le pire, s’adresse au spectateur dans la dignité du partage. Notre visage n’est alors ni défiguré ni même figuré, mais c’est la possibilité pour tous d’un autre récit qui est reconfigurée.
Marie José Mondzain
Interventions en matinée :
- Asiem El Difraoui, politologue et auteur
- Dork Zabunyan, enseignant en cinéma à l’Université Paris 8
Interventions l’après-midi :
- Jean-Louis Comolli, cinéaste et critique
- Marie José Mondzain, philosophe
Chacun des intervenants s’appuiera sur la projection de vidéos et d’extraits de film.
Chaque exposé sera suivi d’un temps d’échange avec le public.