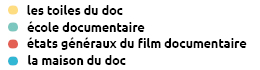2015
2015  Tënk !
Tënk ! Tënk !
Soyons brefs à défaut d’être éloquents.
Deux enseignements marquent cette deuxième édition de la sélection « Tënk ! ». Le premier : cette sélection par la richesse des films montrés et son ampleur – quinze films issus de cinq rencontres Tënk de 2012/2013, Erevan, Saint-Laurent-du-Maroni, Tamatave, Lussas, Saint-Louis-du-Sénégal – a définitivement acquis sa place dans le paysage des États généraux. Une sélection qui marque, c’est tant mieux pour tous les jeunes auteurs et producteurs à qui l’on doit ces regards. Le deuxième enseignement, c’est que le pari de Lussas d’asseoir un rendez-vous de référence sans mettre les films en compétition mais plutôt en symphonie, comme autant d’échos de démarches et de formes qui se répondent, permet plus aisément de penser la programmation comme une mosaïque.
La première matinée démarre par le petit film-entretien qu’a réalisé Henri-François Imbert à Dakar avec le documentariste sénégalais Samba Felix Ndiaye, magnifique traduction du mot et de l’idée même de Tënk. On goûte l’élégance de Samba et au passage son sens aigu de la théâtralité. On ne t’oubliera jamais Samba ! Ensuite, trois essais qui échappent au champ des formes habituelles. Ils sont tous trois issus du Tënk de Lussas. Retour à Berlin d’Arnaud Lambert est un double voyage : géographique entre Berlin et Détroit, temporel entre l’après-guerre et aujourd’hui. Orchestré par la pensée de Jean-Michel Palmier, on est là face à un objet de cinéma qui déclenche d’emblée une distance poétique. Le filmage en travelling et l’utilisation d’une archive radio y sont pour beaucoup. Ce film ne s’évertue pas à documenter : il donne libre cours à la pensée. Suspendu à la nuit d’Eva Tourrent nous plonge dans une dramaturgie du suspens. Le montage, qui privilégie la tension, et le filmage en immersion, de très près, créent des effets de fiction extrêmement puissants qui nous documentent sur le danger et les conditions de travail des pisteurs de station de ski. On est plongé dans l’expérience du travail et de la nuit comme rarement. Enfin, À l’écart de Victoria Darves-Bornoz, du pur cinéma direct, fondé sur l’immersion et un rapport juste à l’univers intérieur de l’unique personnage du film. C’est probablement là que se situe la partie la plus créative du film, tentative réussie de faire exister le temps de l’autre, ce temps si ralenti et si calqué sur celui de la nature et de ses saisons.
L’après-midi du vendredi peut paraître assez « casse-gueule ». En effet, sa thématique autour de la mort peut avoir au premier abord un effet repoussoir. Avec ces trois films réjouissants de diversité et de climat, on découvre comment chacune et chacun des auteurs sont travaillés personnellement, parfois tragiquement, par cette question de la finitude, mais surtout, il y a probablement là, en trois œuvres, la démonstration s’il en fallait une du lien qui existe entre origine culturelle et géographique et écriture cinématographique. Ainsi, dans le premier film, Notre amour a la couleur de la nuit de Galès Moncomble, on est dans une sorte de temps à deux, comme un ultime pacte d’amour où l’inexorable est là sans autre issue possible. Le film est à la fois un acte de création à deux, comme une sorte d’ultime accomplissement – Galès dit à Jacques : « Faisons de ta fin de vie une œuvre » – et dans le même temps, un acte de deuil qui prépare l’après. L’art documentaire dans toute sa puissance, art de l’imaginaire et du réel qui ritualise et permet ainsi de dépasser l’inacceptable. Dans Ma mort ne m’appartient pas de Charles Auguste Koutou, c’est le corps et le ton bonhomme du réalisateur qui marquent d’emblée. Le film n’est pas formellement novateur, mais le réalisateur n’hésite pas à se moquer de la mort en s’interrogeant sur la sienne, et ce ton fait le film. Dans Filme-moi ! de Lera Latipova, on est en plein tragique. La mort frappe ou menace partout dans sa vie. Alors qu’à cela ne tienne ! La réalisatrice, qui joue cash avec le spectateur comme avec elle-même, nous en montre l’absurde. Un voyage décalé entre un journal filmé à la manière des œuvres intimistes ou introspectives qui caractérisent tant depuis deux décennies le film documentaire, et des effets de mise en scène dont celle que propose dans « la vraie vie », à Novossibirsk, un business man de la mort aussi « perché » que notre réalisatrice. Voyage dans l’absurde en compagnie d’une cinéaste douée…
La question qui relie les deux films de la soirée du vendredi soir, celui de Hicham Elladdaqi de Marrakech et celui d’Alain Rakotoarisoa d’Antananarivo est celle de la survie. Comment appartenir socialement au monde des humains si le modèle de société ne vous permet pas de manger ? Ces deux réalisateurs filment en immersion des mini-sociétés qu’ils côtoient et connaissent bien. Dans La Route du pain, on suit « des journaliers » de Marrakech qui vendent leur force de travail aux patrons les plus offrants, quand ceux-ci existent. Mais surtout, Hicham Elladdaqi filme le temps, le temps de l’attente, le temps que l’on tue faute de travail. Dans Rendala, le Mikea, Alain Rakotoarisoa filme, lui, en cinéma direct les derniers des Mikeas, ce peuple Malgache de la forêt que tout et tous condamnent et qui se trouve face à un dilemme pour survivre : vivre caché dans la forêt comme ils le font depuis la colonisation, ou essayer de s’adapter et tenter de vivre avec la société et sa modernité en devenant agriculteurs. Au fil du film, le réalisateur, qui a tissé une relation de confiance avec ces gens, nous permet de voir comment et qui décide du sort bien menacé d’un petit peuple de la forêt.
Samedi matin, deux films-témoignages racontent, l’un en Guinée, l’autre en Tunisie, comment l'on vit avec les déterminismes culturels familiaux. Mais la ressemblance des deux films s’arrête là. Un homme pour ma famille de Thierno Souleymane Diallo est un film pour aider le réalisateur à s’en sortir dans la vraie vie. En effet, Thierno est à l’initiative d’une action concernant l’héritage de son père, et il va tenter de réconcilier la famille et permettre ainsi au père disparu de « dormir en paix » et à la famille de récupérer son territoire (sa concession). On pourrait dire que le réalisateur instrumentalise son documentaire au service d’une cause, mais ce serait oublier qu’en chemin, c’est à une exploration de sa société doublée d’une fable poétique que le réalisateur nous convie. Le film de Sonia Ben Slama Tout est écrit n’est pas un film « pour résoudre une question grave », mais un documentaire qui nous fait prendre conscience de la façon dont fonctionne aujourd’hui la relation au mariage et aux hommes pour des jeunes femmes tunisiennes. Le lien familial qui lie la réalisatrice aux personnages, en particulier la grand-mère et la mariée, lui donne une position d’exploratrice-confidente. Elle nous permet ainsi d’accéder sobrement mais très efficacement à l’intimité et aux limites de ce monde.
Le samedi après-midi est consacré à des histoires individuelles confrontées à la grande histoire : ces films prouvent leur fonction de regard historique et donnent accès, aux citoyens de là-bas comme d’ici, à des pans cachés, minorés ou ignorés de leurs histoires. Le Mythe de Mapout, tourné au Cameroun par Mbog Len Félix Mapout, nous place face à un processus de recherche de la vérité historique. Le réalisateur, à travers une sorte d’enquête familiale, tente de faire le récit du parcours qu’à suivi son père, et dans un double mouvement, souhaite avec ce documentaire réhabiliter le père et ses compagnons « résistants et socialistes » et rendre justice à l’humiliation que l’auteur du film subit depuis l’enfance. C’est ainsi que l’on découvre entre autres que ces « résistants » au Cameroun sont encore aujourd’hui au mieux des oubliés de l’histoire, au pire considérés comme des terroristes. Dans Histoires d’un procès, Alexandra Garcia-Vilà et Franck Moulin sont sur une équation basique : donner à voir les images du procès qui condamne la junte de Videla et ses acolytes et montrer la détermination qui aboutit au procès afin que la vérité soit établie. Ce film explicitement politique s’inscrit dans cette tradition des films qui témoignent. C’est le prolongement par la mémoire documentaire de la justice des hommes. Le cinéma comme témoin et outil de prolongement des luttes. Enfin, pour clore ce pas de deux entre histoire et Histoire, le film d’Arlette Pacquit Héritiers du Vietnam, où il est question de se reconstruire en retournant sur le territoire perdu de l’enfance. Le but final du voyage, le Vietnam, est évidemment débordé par l’intensité du trajet. C’est ce trajet que saisit la réalisatrice en filmant avec beaucoup de finesse l’intimité d’un processus de reconstruction de quelques personnes choisies. Le cinéma est ici convoqué comme enregistrement et mémoire de quelques témoignages de vies abîmées par le tragique de l’Histoire.
Enfin, samedi soir, La Voix des statuettes, où Pascale Touloulou part à la découverte de l’histoire de masques et de statuettes. La réalisatrice mène un film-enquête laissant la part belle au cinéma direct. Elle endosse aussi dans quelques séquences le rôle de personnage. Ce film est une plongée anthropologique doublée d’une histoire personnelle, un beau final.
Jean-Marie Barbe
En complément de ce programme, les États généraux vous proposent La Chambre bleue de Paul Costes, présenté au Tënk de Lussas et lauréat de la bourse « Brouillon d’un rêve ».
Débats animés par Jean-Marie Barbe.