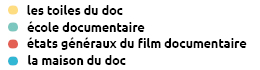2014
2014  Fragment d'une œuvre : Sándor Sára
Fragment d'une œuvre : Sándor Sára Fragment d'une œuvre : Sándor Sára
Origines
Je suis né à la campagne et j'ai vécu dans plusieurs villages et villes de la Hongrie, ce qui a beaucoup élargi mes horizons. Dans mes films, on retrouve naturellement ces lieux, les gens qui les habitent, avec leurs coutumes, leurs traditions, et mes propres expériences. Bien sûr, je connais Budapest et j'ai aussi été dans le complexe métallurgique de Csepel, mais je n'ai jamais pensé en faire un film. C'est un monde différent du mien : je suis très lié à la nature et à un mode de vie simple, rural. N'ayant pas été admis à l'Académie de cinéma, j'ai alors travaillé comme géographe en plusieurs parties de la Hongrie et j'ai pu mieux connaître le pays. D'une certaine manière, dans mes films j'ai essayé — souvent involontairement — de représenter tout le bassin des Carpates.
Formation
Quand j'ai pris la décision d'être opérateur, je suis allé dans une grande bibliothèque de la capitale pour lire tout ce qui s'y trouvait sur le cinéma et la photographie. Il n'y avait pas grand-chose mais j'ai découvert des auteurs comme Béla Balázs ou Iván Hevesy. Balázs m'a surtout passionné, parce qu'il écrivait sur l'image comme d'autres écrivent sur l'amour, avec le même enthousiasme. Outre mon intérêt personnel, c'est de là qu'est venue mon obsession pour les images. Plus tard, à l'académie, j'ai connu la tradition de la photographie et j'ai été surpris par la ressemblance de mes photos avec celles, sociologiques, de Kata Kálmán et d'autres que je ne connaissais pas encore, tant du point de vue des sujets que de la manière de voir. Dans les années 1950, il était difficile d'avoir accès à ces photos, mais à la bibliothèque de l'académie nous pouvions consulter les livres interdits grâce à une bibliothécaire formidable qui aidait les jeunes issus de milieux moins cultivés, comme István Gaál et moi. Nous ne nous souciions pas des canons de la littérature ou de l'art officiels, mais nous tentions de représenter le monde tel que nous le voyions. Il y a peu de temps j'ai retrouvé une photo que j'avais prise à l'époque : l'image d'un cochon ! Tel était le regard naturel et émerveillé que nous portions sur le monde. Une fois, j'ai photographié un garçon qui portait à la bouche une prune avec tellement de plaisir que même son gros orteil en était courbé. La composition et l'éclairage étaient réussis mais les autorités de l'académie ont refusé la photo, prétextant qu'elle était mauvaise parce qu'il n'y avait plus de garçons déchaussés dans notre pays... Nous n'avions quasiment aucune information sur l'art moderne occidental. À l'académie, nous nous étions arrêtés avant l'impressionnisme. C'est grâce à notre professeure d'arts figuratifs que nous avons connu les impressionnistes et des artistes plus récents. Ensuite, grâce aux livres d'art de quelques bibliothèques privées, nous avons découvert les nouvelles tendances artistiques, qui m'intéressaient beaucoup. Une fois, j'ai fait des photos d'une grande cloche en verre remplie d'eau dans laquelle j'avais versé quelques gouttes d'encre : des images très belles, « tachistes ». Mais j'ai bientôt éprouvé à nouveau le besoin de sortir photographier les gens.
Documentaire et fiction
Selon l'idéologie officielle, les artistes devaient représenter la réalité telle qu'ils la voyaient et la vivaient. On accusait souvent les cinéastes de s'enfermer dans les cafés et d'inventer des histoires irréelles plutôt que d'observer la réalité. Alors nous avons commencé à l'observer, mais nous avons vite compris que les autorités considéraient la représentation de la réalité existante comme une erreur bien plus grave que l'invention d'une autre réalité. En même temps, grâce à la photo, nous avons été confrontés à l'expérience de ne pas pouvoir mentir : une vieille personne, il fallait la photographier avec toutes ses rides qui sont les signes de la vie. Nous ne voulions pas cacher la réalité. Plus tard, alors que la censure voulait faire couper dans mon film Néptanítók (1981) les séquences liées aux événements de 1956 — c'était l'un des grands tabous, avec la guerre, l'Union Soviétique, les goulags... — j'ai répondu qu'on ne pouvait pas couper trois ans de la vie d'une personne, comme si 1956 et la terreur qui s'ensuivit n'avaient jamais existé ! Cette posture s'est transmise aux films de fiction : si nous n'étions pas disposés à falsifier la vie des autres, comment aurais-je pu falsifier la mienne dans un film aussi autobiographique que Feldobott kő (1968), mon premier long métrage ? Par la suite, j'ai essayé d'explorer d'autres directions, par exemple le grotesque et l'absurde avec Holnap lesz fácán (1974) : mais ce style-là était encore plus difficile à défendre que le premier et absolument intolérable pour le pouvoir.
Ce n'est pas un hasard si mon documentaire Sír az út előttem (1986) a gagné le Grand Prix du meilleur long métrage de fiction au festival de Budapest. Je me souviens que le président du jury a dit : « Il n'est pas important qu'un film soit un documentaire ou une fiction s'il provoque une catharsis chez les spectateurs. » L'important est d'obtenir un effet émotionnel fort, ce qui est souvent le cas dans mes documentaires qui traitent d'histoires très dures et intenses. Ces films constituaient une force énorme envers les censeurs, car ils déplaçaient toujours davantage les murailles construites par le pouvoir, en même temps que l'affaiblissement du régime de Kádár entraînait une lente diminution des tabous.
De l'image à la parole
Un de mes premiers films, Vízkereszt (1967), parle d'un million de personnes qui vivaient dans des conditions difficiles, dans des maisons éparpillées dans les campagnes hongroises. J'ai bien connu ce monde, mais en préparant le film j'ai lu aussi beaucoup de livres de sociologie. Pourtant, je ne voulais pas faire un film d'entretiens, un film « parlant », et j'ai pensé que la visite d'un groupe de théâtre de Budapest dans ce monde difficile pouvait représenter au mieux la vie dans ces maisons misérables et isolées. J'ai raconté cela presque exclusivement par des images, sans dialogue. En revanche, on ne peut pas raconter la guerre de la même manière. Pour raconter des histoires du passé je peux recourir à la fiction, ou à l'entretien.
À partir des années 1980, moi qui ne jurais que par les images, j'ai commencé à réaliser des films dans lesquels il n'y a plus que des visages et des récits. La vraie décision a été sans doute de renoncer aux images en faveur de la parole. J'ai interviewé des centaines de personnes parce que leurs récits se confirmaient réciproquement. Ainsi, la première personne commence une histoire que termine la quatrième, comme s'il s'agissait de l'histoire d'une seule personne, d'un portait choral, constitué de détails choisis à partir de récits et de portraits particuliers. Il arrive alors quelque chose d'étrange et d'imprévisible : tandis que le spectateur regarde et écoute ces « têtes parlantes » — on me l'a beaucoup reproché — tout d'un coup, sur l'écran de son imagination, il commence à voir non seulement les visages, mais aussi les histoires qui sont racontées.
Passé et présent
Nous avions compris que le pouvoir mentait. Quelqu'un de sensible, d'autant plus s'il est jeune, supporte difficilement le mensonge et essaie de raconter son expérience personnelle — sauf s'il est carriériste, mais nous ne l'étions pas. Au studio Béla Balázs, nous nous enseignions les uns les autres à ne pas mentir. Nous voulions raconter ce qui s'était passé et ce qui se passait vraiment, en osant le réalisme mais aussi en y introduisant de la poésie. Les films du studio Béla Balázs sont à la fois authentiques et poétiques, aussi grâce au fait que nous avons pu y travailler plus librement que dans la grande production. Certes, le pouvoir s'était assuré une forme de contrôle, car il n'était pas obligatoire de montrer nos films, et certains furent censurés pour une période plus ou moins longue. Mais ils existaient ! À cette époque, on ne pouvait pas parler des faibles, des victimes, des perdants — tout cela était tabou mais nous avons insisté pour en parler. J'ai gardé la même attitude dans mes documentaires des années 1980 et 1990. Je n'ai jamais dû réfléchir aux sujets, j'ai toujours choisi ceux qui étaient interdits. De nos jours, il y a sûrement des problèmes sociaux très graves dont on parle beaucoup moins. Il me semble toutefois que la politique ne soit pas la seule coupable. Il serait possible d'aborder n'importe quel sujet difficile mais c'est en quelque sorte l'intention qui manque. La vidéo permettrait d'interviewer des centaines de personnes afin de chercher les problèmes graves ou préoccupants, mais je crois que la détermination des auteurs fait défaut. Il est aussi vrai que le monde a radicalement changé, et peut-être personne ne croit plus qu'on puisse changer les choses. Quand nous avons commencé à travailler, nous avons découvert des terrains inconnus, et chaque époque doit trouver les thèmes les plus brûlants. Je dis souvent qu'il faudrait faire des documentaires sur les banquiers, même si les faire parler est très difficile.
Propos recueillis et traduits par Dario Marchiori et Judit Pintér.
Débats animés par Dario Marchiori.