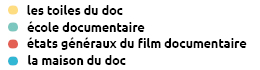2013
2013  Le Peuple à l'écran ?
Le Peuple à l'écran ? Le Peuple à l'écran ?
Représenter le peuple
Au sein du cinéma documentaire, la question du peuple et de ses représentations a souvent constitué une interrogation majeure. Encore et toujours, on bute contre cette question : peut-on vraiment représenter le peuple ? L’enjeu esthétique et l’enjeu politique s’entrelacent dans cette question, au point d’en devenir inextricables. Car toute représentation implique bien deux versants : représenter quelqu’un, c’est parler en son nom, en ses lieu et place, et faire entendre ses droits. Mais faire entendre les droits de quelqu’un (et c’est là le second versant), c’est aussi faire entendre sa voix, la rendre perceptible et rendre sensible l’auditoire à son histoire. Bien souvent, la question politique (ou juridique) se joue sur cette dimension esthétique (et sensible), tandis qu’à l’inverse, ce qui se présente comme un simple choix formel relève déjà d’un choix politique : il y a bien une politique du cadrage, qui orchestre d’emblée une séparation entre ceux qui seront vus et entendus et ceux qui demeureront dans le hors-champ.
Par rapport à une tradition de cinéma de représentation, qui se construit autour de quelques personnages privilégiés et de leurs (mises en) intrigues, le cinéma documentaire a, au contraire, souvent préféré l’exploration des marges, pour faire entendre ces voix dont on ne raconte que rarement l’histoire. Des mouvements d’avant-garde, comme le groupe Dziga Vertov dans les années soixante par exemple, qui se rattache à l’esthétique soviétique du kinoki, conçoivent leur documentarisme militant comme un effort pour remplacer la représentation par la documentation, et redonner la parole aux acteurs, et non à ceux qui croient pouvoir parler en leur nom. Or, il n’est pas si facile de se défaire du discours par procuration et des schèmes imposés : c’est ce que Jean-Luc Godard, pourtant initialement instigateur du mouvement Dziga Vertov, n’a cessé de souligner par la suite, notamment dans Tout va bien, qui peut se lire comme une critique d’un cinéma aveuglé par l’idée d’une « prise directe ».
La critique du discours de représentation ne s’est longtemps cantonnée qu’à une moitié du problème : elle n’a conçu la représentation que comme une opération de substitution indue, d’une usurpation de souveraineté. Redonner la parole aux acteurs eux-mêmes, ce serait donc en finir avec toute représentation. C’est encore l’opinion de Foucault et de Deleuze, qui – contre Sartre et la figure de l’intellectuel croyant pouvoir parler au nom de la vérité du prolétariat – affirmaient que les masses n’ont besoin de personne pour savoir ce qu’elles veulent, qu’elles le « savent parfaitement […] et le disent fort bien » (Les intellectuels et le pouvoir, 1972). Mais qu’est-ce que fort bien dire ce que l’on veut, quand le problème n’est plus tant l’accès aux moyens de communication (du micro-trottoir à l’explosion de la blogosphère, jamais une époque n’avait autant raffolé du point de vue du citoyen « ordinaire ») mais bien la manière dont certains discours peuvent être entendus ou non.
Dans un essai qui a fait date au sein des études postcoloniales (Les subalternes peuvent-elles parler ?, 1988), la philosophe d’origine indienne Gayatri Spivak a reproché à Foucault et à Deleuze d’avoir réduit le problème de la représentation à un problème de substitution (Stellvertretung) et de n’avoir pas suffisamment insisté sur la dimension sensible (Darstellung). Toute parole, même directe, prend inévitablement une certaine forme et pour que ce que l’on dit puisse être entendu, il faut parler fort bien – or c’est précisément ce qu’un subalterne (ou une subalterne) ne sait pas faire. Quelle serait une forme de documentaire qui, échappant à l’alternative d’un discours par procuration et d’un fantasme de la parole originaire, saurait faire part à ces réalités mineures, périphériques et marginales ? Qu’est-ce qu’un cinéma qui – par-delà l’alternative de la représentation ou de la transparence – permet de rendre à nouveau sensible à certaines réalités qui échappent habituellement au regard ? Et qu’est-ce enfin, pour reprendre la belle invitation de Francis Ponge, que de « donner la parole à la minorité en nous-mêmes » ?
Emmanuel Alloa
Porter Plainte
Il ne faut pas se plaindre, il faut porter plainte. Pour cela il faut engager la pensée, l’écriture ou l’image dans un geste consistant à rendre sensible notre monde historique. Qu’est-ce que cela veut dire ? Cela ne veut pas dire, n’en déplaise aux étroites versions du platonisme ou du rationalisme contemporains, rendre inintelligible. Si Walter Benjamin a construit toute son approche de la « lisibilité de l’histoire » autour de la notion d’image dialectique — et non, par exemple, sur celles d’« idée dialectique » voire d’« idée de la dialectique » —, c’est bien que l’intelligibilité historique et anthropologique ne va pas sans une dialectique des images, des apparences, des apparitions, des gestes, des regards… tout ce que l’on pourrait appeler des événements sensibles. Quant à la puissance de lisibilité dont ces événements sont porteurs, elle n’est efficace que parce qu’il entre dans l’efficacité même des images de rendre accessibles, de faire lever, non pas seulement les aspects des choses ou des états de faits, mais bien leurs « points sensibles », comme on le dit si bien pour signifier où cela fonctionne à l’excès, où cela cloche éventuellement, là où tout se divise dans le déploiement dialectique des mémoires, des désirs, des conflits.
Rendre sensible, ce serait donc rendre les choses, les êtres, les événements, accessibles par les sens, et rendre même accessible ce que nos sens, de même que nos intelligences, ne savent pas toujours percevoir comme « faisant sens » : quelque chose qui n’apparaît que comme faille dans le sens, indice ou symptôme. Mais, dans un troisième sens, « rendre sensible » veut dire aussi que nous-mêmes, devant ces failles ou ces symptômes, devenons tout à coup « sensibles » à quelque chose de la vie des peuples — à quelque chose de l’histoire — qui nous échappait jusque-là mais qui nous « regarde » directement. Nous voici donc « rendus sensibles » ou sensitifs à quelque chose de nouveau dans l’histoire des peuples que nous désirons, par conséquent, connaître, comprendre et accompagner. Voici nos sens, mais aussi nos productions signifiantes sur le monde historique, émus par ce « rendre-sensible » : émus dans le double sens d’une mise en émotion et d’une mise en mouvement de la pensée.
Devant la « déclaration d’impouvoir » des peuples — telle qu’elle peut nous être rendue sensible dans le montage des textes de James Agee et des images photographiques de Walker Evans, ou bien dans tel film de Wang Bing ou de bien d’autres cinéastes —, nous voici aux prises avec tout un monde d’émotions dialectiques, comme s’il fallait à la lisibilité de l’histoire cette particulière disposition affective qui nous saisit devant les images dialectiques : la formule avec le pathos qui la divise pourtant, l’intelligible avec le sensible qui le bouleverse pourtant. Porter plainte : placer les émotions collectives au lieu même qu’elles visent (« L’émotion ne dit pas je », disait bien Gilles Deleuze), à savoir la revendication des peuples à être dignement représentés.
Georges Didi-Huberman
Filmer le peuple : affaire de zonards et d’idiots ?
Filmer le peuple ? Est-ce même possible ? Personne n’a jamais vu le Peuple et son invisibilité le rend infigurable, irreprésentable. Pourtant, le Peuple va trouver forme, figurabilité et voix dans les corps filmés par les cinéastes dont le regard accueille les singularités les plus irréductibles et donne sa visibilité à cette invisible communauté. Ce qui voudrait dire que le peuple ne peut s’incarner au cinéma que si le geste cinématographique le soustrait à toute généralisation, à toute figure du nombre, de la multitude ou de la masse, pour faire surgir dans le sensible la puissance universelle de particules les plus individuées, dans leur distinction irremplaçable, fussent-elles en apparence les plus insignifiantes et les plus vouées au silence et à la disparition. Eisenstein portait à chaque visage, à chaque corps de la misère et de la révolte une attention si aigüe que le peuple ne pouvait se dire que par la voie des visages et des noms propres. C’est ainsi que le Peuple devient à son tour un nom propre et comme tel digne de la majuscule. Ce propre qui est la conquête et la propriété du Peuple, le cinéma documentaire l’accueille et le donne à voir sous le signe de l’infime et du particulier. La pensée grecque nommait idiotès ce sujet singulier dont la particularité s’est déployée dans la littérature, la philosophie et le cinéma sous le signe de l’Idiot, c’est-à-dire du simple d’esprit, désigné dans son écart, sa solitude, son silence ou sa folie. C’est au titre de l’idiotie prise dans toute sa complexité, que s’opère le nouage de la poésie, de la liberté et de l’exclusion. De l’idiot de Dostoievski à Ninetto Davoli dans les films de Pasolini, le Peuple devient visible dans la zone où se manifeste le hors champ de son innocence et de sa puissante lucidité. Filmer le Peuple c’est donc non seulement filmer les plus extrêmes singularités mais c’est aussi inscrire leur destin incomparable dans les lieux spécifiques de l’indétermination : les zones inhabitables peuplées d’êtres échappant à toute identification, à toute police. Dans l’Antiquité, les « idiots » allaient au désert ; aujourd’hui, ils sont en banlieue, clandestins ou marginaux, d’autres vagabondent dans les terrains vagues, s’abritent dans des lieux de ruines ou d’exil fût-ce au cœur des villes. C’est pourquoi l’image doit elle-même se faire « zonarde » quand elle prend en charge la visibilité du Peuple dans cette zone où chaque figure incarne la forme sensible et lumineuse de ce que la philosophie voudrait comprendre sous le titre de la « condition humaine » et de l’énergie politique de toute création. Le Peuple est souvent muet et pourtant ces corps filmés ressemblent à des cristaux, ils sont porteurs de sens et, à leur façon, révolutionnaire. Le Peuple ainsi filmé en chaque corps « idiot » s’incarne dans l’image d’une présence incandescente, à la fois éclairante et visionnaire. N’est-ce pas la question radicale que partagent le cinéma et la philosophie, à savoir d’être l’un et l’autre des pratiques de la contre évidence et l’exercice périlleux de qui désire respecter ensemble l’ordre de la raison et la vérité du désordre. Telle est dans sa torsion la tâche émancipatrice de toute image qui offre à son tour sa puissance transformatrice au Peuple des spectateurs.
Je propose de partager la réflexion autour de quelques documentaires de Wang Bing, Artur Aristakisian, Ritwik Ghatak et avec Mary Jiménez et Bénédicte Lienard.
Marie-Josée Mondzain
Déroulé du séminaire :
- Mardi 20 août, à 10 h, en salle 2
Intervention de Emmanuel Alloa
- Mardi 20 août, à 14h30, en salle 2
Intervention de Georges Didi-Huberman
- Mercredi 21 août, à 10 h, en salle 2
Projection du film Sur les braises, suivie de l'intervention de Marie-José Mondzain
- Mercredi 21, à 14h30, en salle 2
Suite de l'intervention de Marie-José Mondzain suivie d'un débat avec Emmanuel Alloa et Georges Didi-Huberman
En présence de Emmanuel Alloa, Georges Didi-Huberman, Marie-José Mondzain.