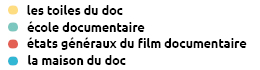2008
2008  Formes de lutte et lutte des formes - Pièges du formatage ou promesses de la forme ?
Formes de lutte et lutte des formes - Pièges du formatage ou promesses de la forme ? Formes de lutte et lutte des formes - Pièges du formatage ou promesses de la forme ?
Incidence du moindre geste
Cinéma et politique ? Nous étions quelques-uns aux lendemains de mai 68 à prétendre renverser la donne : il ne s’agissait pas de faire des « films politiques » mais de « filmer politiquement »1. Cette phrase pouvait être mal comprise. Voulait-elle dire qu’il fallait filmer en « suivant » une ligne politique déterminée ? Et non pas seulement impliquer, mais appliquer une politique ? Qu’on me permette de répondre par une citation de Guy Debord : « On ne conteste jamais réellement une organisation de l’existence sans contester toutes les formes de langage qui appartiennent à cette organisation. » La phrase vient du film Sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps et le film date de 1959. Dite par Debord lui-même, elle est accompagnée d’une précision : « L’écran reste blanc »2. Nous qui, dix ans plus tard, n’étions pas partisans de l’écran blanc, loin de là, nous faisions pourtant nôtre cette question : comment combattre la domination sans recourir au langage même de la domination ?
Aujourd’hui, il devient clair que la logique destructrice du capital se traduit, du côté des images et des sons, par la destruction de toute dimension d’autonomie chez le spectateur. Pris par la main, je suis sommé de suivre le commentaire magistral tel que les mots du journaliste (du « guide ») vident les images de tout mystère et de toute grâce. Le spectateur n’est plus posé qu’en consommateur prié d’en rester au plus compulsif des passages à l’acte : celui de payer la marchandise. L’imaginaire est balisé, indexé. Les divers formatages qui affectent non seulement les programmes de télévision, mais les grands médias, mais l’école, mais l’entreprise, mais le loisir avec la ritournelle du langage sportif, ont pour ambition – de moins en moins dissimulée – de normer les sujets, de les conformer en les enfermant dans des rhétoriques narratives, des schèmes explicatifs et des formes langagières qui modèlent des manières d’agir et de penser. Le langage de l’entreprise capitaliste est devenu celui de tous. Le « visuel » aussi. Comme les patrons, comme les maîtres du monde, nous parlons performances, efficacité, succès, profils et profits. La publicité, l’information, le divertissement, le spectacle occupent les nuées d’images, les nuées de sons qui forment notre atmosphère et à travers lesquelles nous respirons, nous voyons et entendons le monde. Ce qui se passe chez nous du côté des télévisions publiques en est l’effrayante démonstration. Le « formatage » systématique des fictions et documentaires a-t-il d’autre but qu’une mise au pas de ce qui pourrait paraître menacer l’ordre – économique aussi bien qu’esthétique – établi ? Formater, n’est-ce pas répéter dans ses propres termes la « soumission volontaire » au divertissement, à la distraction, n’est-ce pas reconduire l’aliénation ?
C’est une naïveté de croire que les idées, les thèmes, les énoncés rebelles garantissent à eux seuls la rébellion contre les maîtres. Nous sommes enfermés dans une culture du contenu, dans un positivisme du message. Le rôle des formes paraît n’être plus que décoratif : du design politique, en somme. Or, c’est bien par les systèmes de signes que passent les énoncés. Par les positions d’énonciation, par la forme des images et des sons, des récits et des langages. Combattre les idées dominantes dans les formes mêmes qui les font dominer, c’est encore les relayer et assurer leur pouvoir. Comment imaginer un cinéma politique qui ne mette pas en crise d’une manière ou d’une autre ses conditions de production, son système d’écriture, l’idéologie qui les coiffe ? Le cinéma documentaire, pour parler de lui, ne doit-il pas rompre avec le mode journalistique dominant (dossiers, magazines… type Le Monde selon Bush ou Fahrenheit 9-11) ? L’information spectaculaire-marchande qui a pris le pouvoir dans les télévisions y impose une écriture émiettée et désincarnée, balisée et surlignée, publicitaire et marchande qu’il est urgent de rejeter. Jamais nous n’avions connu en Occident pareil effort de réglage des consciences à travers les formes du discours ou de l’image. La pratique des religions était moins totalitaire.
La télévision, le cinéma peuvent tout aborder, oser toutes les transgressions, les sujets dits « difficiles », pourvu que ce soit dans une forme tranquille, canonique. Distiller le conflictuel d’une manière rassurante, qui apprivoise l’enjeu « sauvage » annoncé. Le subversif traité familièrement ne l’est plus tant : il a été acclimaté, assaini, nettoyé de ses dangers. Offert, autrement dit, à la jouissance d’un spectateur à qui l’on épargne précisément tout risque d’être engagé lui-même dans un déplacement de sa place, un bousculement de son ordre. S’il y a une fonction démiurgique et consolatrice du cinéma, c’est bien parce qu’il ne se satisfait pas de ce qui est déjà là, déjà formé et formulé, et qu’il s’acharne à reconstruire le monde, à le montrer comme encore en construction. C’est l’utopie portée par le cinéma et on peut bien lui donner le beau nom de « politique ».
Jean-Louis Comolli
1 Nous : autour des Cahiers du cinéma, de Cinéthique, avec Jean-Luc Godard et le Groupe Dziga Vertov.
2 Cf. Guy Debord, Œuvres, Quarto, Gallimard.
Tout au long des années soixante, le cinéma direct a libéré la parole, enregistrant conjointement les images et les sons sans forcément les monter ensemble, filmant les êtres et ce qu’ils avaient à nous dire personnellement, créant un formidable appel d’air. Dans le documentaire, il enterra la dictature du commentaire venu d’en haut, de ces voix expertes parlant toujours à la place des autres, jusqu’alors trop souvent assénées comme en chaire et désormais tenues de céder leur place à la multitude des corps filmés s’exprimant librement, sur leurs lieux de travail ou d’existence. Ce fut alors une incroyable envolée d’accents, d’intonations, de parlures, comme autant de lâchers de ballons épuisant le discours des maîtres sous la polyphonie des humbles et des êtres ordinaires. Et sans doute ne s’agissait-il pas d’un hasard si ce nouveau chant du monde nous venait d’abord de l’Afrique (Jean Rouch), du Québec (Pierre Perrault) ou de la classe ouvrière (le cinéma des groupes Medvedkine), pays réels ou genre humain assourdis par la langue des puissants — coloniaux, voisins anglophones ou patrons — où l’on fut longtemps prié de se taire. Pour ces cinéastes comme pour Fernand Deligny, leur contemporain, le geste documentaire avait alors la portée d’une utopie sociale, offrant de pouvoir se dire à ceux qu’on n’entend pas ou « d’écrire l’histoire de ceux qui n’écrivent pas ». À tous ceux-là, filmés depuis leurs réalités mêmes, de l’intérieur de leurs récits, de leurs mensonges, entre gravité et plaisir de se construire, le cinéma proposait de nouvelles règles du jeu dans une forme de joie collective : tout simplement de devenir acteurs à leur tour, de leur vie, dans les films. En ce sens, le cinéma direct préfigurerait mai 68, raison pour laquelle, à sa façon, il fut une révolution.
Hypothèse d’iconoclaste ? Il faut d’urgence revoir Jaguar dont le montage ne s’est achevé qu’en 1967. Explosion de la parole, inversion des rôles, acteurs à présent scénaristes, sortie des fonctions assignées, rupture avec la vieille division du travail à l’œuvre dans le cinéma industriel, abandon du format professionnel (pour le CNC, le 16 mm est dit « format amateur ») : tout ce qui se met en place dans ce film traduit déjà les aspirations des acteurs de mai. Du reste, Reprise du travail aux usines Wonder, le film emblématique de la période, n’est-il pas à sa manière une ciné-transe ? Quant à la trilogie de Pierre Perrault, dite de l’Île-aux-Coudres, comment ne pas voir qu’elle aussi célèbre une langue souveraine, essentiellement définie par ses valeurs d’usage, c’est-à-dire par ce qu’elle fonde et féconde, ce qu’elle ouvre dans les films et permet ensuite au dehors ? Ici encore, la parole ne se demande pas, elle se prend, à la manière d’un destin, car si l’on parle, c’est avant tout pour bâtir, pour ne rien dire qui n’engage pour la suite à construire. Parler pour mettre en jeu, en selle, en état de marche ce qui regarde tout le monde et relève du sort commun : telle est bien la fonction que réservera ensuite 68 au langage. Au commencement est le Verbe, voilà une règle politique, un principe de mise en scène.
Mai 68, précisément. Contrairement aux idées reçues, les législatives de juin n’ont pas scellé son sort. Si politiquement, la cause semble entendue, cinématographiquement on ne s’est pas quitté comme ça : la séquence dura douze ans, de 1967 (naissance du groupe Medvedkine de Besançon) à 1979 (Lorraine, cœur d’acier), avant de s’assécher dans les marais salants du mitterrandisme. Cinéma militant, dira-t-on, pour mieux l’ensevelir sous les épitaphes méprisantes (au hasard : « emmerdant », « dogmatique », « périmé »), histoire de refuser de voir qu’entre les pionniers du direct et le fameux documentaire de création des années 80, concept institutionnel attrape-tout, le cinéma militant est tout simplement le chaînon manquant. Cinéma partisan, précisera-t-on encore. Et alors ? Comme tout film qui ne se cache pas, sans s’exhiber pour autant, et s’engage au tournage à se laisser travailler sous nos yeux par sa matière, comme tout film de cinéma quand ses raisons, ses questions, sont ce qui, dans la salle, nous travaille en retour. Car si les équipes de l’ARC, de Ligne Rouge, de Cinélutte notamment, militèrent à découvert, elles le firent aussi pour l’amour du cinéma. La beauté des grands films militants tient d’abord à cette fragilité, à cet écart permanent entre programme politique au sens strict et projet cinématographique, entre rigidité des mots d’ordre et souplesse documentaire. Lénine, le Che ou le grand Timonier ne rôdent jamais seuls dans ces films singulièrement peuplés, y côtoyant sans cesse Howard Hawks et John Ford, Henry Fonda et John Wayne, les grands films soviétiques et le mélo néoréaliste. Ainsi peut-on voir Un simple exemple, film majeur de Cinélutte, comme une comédie musicale prolétarienne, le film d’une parole enchantée d’avoir osé enfin s’exprimer.
Suivant cette conception du cinéma, trajet de la parole et travail du film n’avancent jamais l’un sans l’autre, se découvrant au contraire mutuellement, chemin faisant. Question de confiance. Indissociable du geste documentaire qui la fait naître, la parole devient alors levure, acte physique de transformation du monde, une forme offerte à la Révolution.
Patrick Leboutte
Le texte emblématique de Guy Debord indique une forte direction critique : celle d’une mobilisation des gestes et de la pensée quand il s’agit non seulement de résister à l’emprise d’une domination économique et politique mais aussi de forger les armes d’une émancipation de tous ceux qui sont privés de pouvoir et de parole. Debord pressentait avec une grande acuité que le monde de la communication audiovisuelle était en train de devenir non plus la superstructure idéologique du capitalisme comme Marx avait pu la décrire, mais son infrastructure même. L’image est le régime constituant de l’emprise du capitalisme sur des sujets dont la pensée est progressivement confisquée par l’industrialisation de toutes les opérations symboliques dans la seule perspective du profit et du marché. Dès lors comment résister, comment combattre, comment changer un monde avec les armes de l’image qui sont celles de l’oppresseur ? Faire du cinéma n’est plus possible, pensait alors Debord, et il l’exprimait dans des textes mais paradoxalement aussi dans des films qui tentaient d’échapper à toutes les formes admises de la fiction comme du documentaire. Ses films tentaient d’être des cris de révolte et des armes de contestation censés modifier les consciences et transformer le monde en transformant l’écoute et la vision. Il n’imaginait pas qu’il fût possible d’user des armes de la vision pour libérer la pensée et construire un nouveau regard. Il condamnait tout spectacle parce que ce monde du spectacle est tout entier dévolu à la jouissance des yeux, au renouvellement ininterrompu des biens dont ils doivent se repaître, et cela dans un traitement du temps totalement indexé sur le rythme de la consommation et des profits escomptés. Faut-il condamner le spectacle et procéder à l’inhumation du spectateur ?
À Lussas, nous tenterons de nous ressaisir des ressources de cette critique qui, elle, date déjà d’un demi-siècle, afin d’en comprendre les usages possibles et les limites pour nous aujourd’hui. Dans quelle mesure les industries de l’image, et plus particulièrement le cinéma, peuvent-ils constituer le terrain même d’une résistance et d’un combat ? Dans quelles conditions matérielles et avec quelles exigences formelles ? Si nous voulons bien considérer que les opérations symboliques, les gestes créatifs et les énergies critiques ne peuvent exister que sur le socle irrécusable de notre puissance imaginaire et de notre capacité à produire des images, alors il faut bien admettre que c’est en défendant l’art des images et non en les condamnant massivement, que nous pourrons construire les possibilités d’un autre monde. Bannir l’image, c’est bannir le sujet dans sa libre relation au possible et le réduire définitivement aux seuls paramètres d’un présent sans avenir où il n’est que consommateur et agent immédiat du marché. Il nous faut donc constituer des ressources critiques qui permettent à chacun de résister à la confiscation de notre dignité et de notre liberté et désigner les nouvelles conditions du spectacle du monde, celles qui feront du spectateur le sujet d’une adresse et le site d’une promesse. Il s’agit bien d’une réflexion sur la signification politique des choix esthétiques et matériels en tant qu’ils déterminent ensemble la condition du sujet de la croyance et celle du citoyen. Il n’est d’art que si le plaisir du corps est une chance pour la liberté de la pensée.
Dans le cadre de la réflexion spécifique qui se déploie à Lussas, cette position signifie que peuvent se croiser dans un même séminaire la parole et les pratiques de ceux qui évoluent à l’intérieur de la création documentaire et de ceux qui travaillent sur ses marges soit à titre critique soit depuis le lieu singulier et inassignable de la philosophie. Encore faut-il que celle-ci considère que les enjeux de l’image sont indissociables de ceux qui font exister le sujet du désir et de la pensée au milieu d’un monde que ce sujet veut partager et qu’il désire transformer.
En ce qui me concerne, j’ai mis l’image et les opérations imageantes au centre du questionnement anthropologique et de la question politique. La situation de spectateur n’est autre que celle de tout sujet humain, qui se sépare de ce qu’il voit pour pouvoir en produire l’image sensible et pour choisir la nature des liens qu’il tisse grâce à elle avec le monde.
Dans le cadre des trois journées du séminaire, j’ai choisi de m’arrêter sur quelques thèmes particuliers qui m’ont semblé propres à stimuler le regard en termes de résistance, à donner forme à des figures singulières de la lutte contre tout dispositif d’enfermement des turbulences imaginaires. Il s’agit en premier lieu du rapport du silence au son et à la voix dans certains documentaires, question inséparable du traitement des temporalités dans l’image, en second lieu du mélange des genres comme forme de résistance au formatage et à l’étanchéité des classifications marchandes, en troisième lieu des ressources du comique, du rire, de l’ironie et de l’humour comme énergie révolutionnaire. Les films ou extraits présentés ne se répartissent pas les tâches entre ces thématiques. Par exemple, un film comme Tableau avec chutes de Pazienza travaille avec le mélange, le rire et le désastre, Changer d’image de Godard également, mais d’une tout autre façon. Les Mots et la Mort de Bernard Cuau œuvre entre l’image, la voix et l’ombre d’une écriture alors que Berzosa trace toujours sa voie entre l’ironie, la cruauté et le désastre. Comment classer Film de Samuel Beckett qui met en scène le silencieux délire du doute cartésien ? Tous ces exercices de déraison auxquels Debord avait dans sa folie lucide donné le coup d’envoi, nous les reprenons ensemble pour défendre plus que jamais l’art des images et du cinéma contre les nouvelles rationalités meurtrières du marché, des industries dites culturelles, des programmes dits de divertissement. C’est en voyant et revoyant ensemble ces films qui luttent et qui ne renoncent pas à nous faire rêver, que nous construirons ensemble à notre tour de nouvelles figures pour nos combats. Bamako d’Abderrahmane Sissako est à mes yeux emblématique des enjeux de notre rencontre.
Marie-José Mondzain
Coordination : Jean-Louis Comolli, Patrick Leboutte, Marie-José Mondzain.