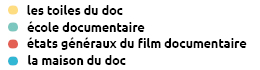2007
2007  Territoires du sonore
Territoires du sonore Territoires du sonore
Territoires du sonore, du côté des pratiques
Avant de s’engager vers ce nouveau rendez-vous, il faut rappeler un préalable désigné lors de notre précédent séminaire « Territoires du sonore » (Lussas 2006).
Aborder la question du son au cinéma suppose de s’interroger sur la nature et sur le rôle des sons que l’on souhaite confronter à l’image mais aussi sur les méthodes de choix, leur place et les opérations à organiser pour les prendre ; enfin à quel moment cela doit-il avoir lieu ?
Si nous avions confirmé que la post-production était un moment déterminant, nous avions indiqué aussi qu’il ne fallait pas pour autant oublier le travail situé en amont, c’est-à-dire ce qui se rassemble sous le terme de prise de son. Ce terme laisse oublier la mise en scène qui lui est corrélée. Nous avions ajouté que cette question ne se réglait pas en déléguant ce travail à un spécialiste, c’est-à-dire à son ingénieur du son pour la simple raison que les choix ne sont pas toujours implicites. Bien plus, il y a à cet endroit un véritable lieu de création qui n’est pas assez considéré, un lieu de constitution de la forme, de sélection et d’organisation des contenus. En conséquence, nous avons rappelé que cette opération relève de la mise en scène et de la réalisation.
Dans la simple opération de filmer une personne qui parle, la liberté dans les tâches n’est pas également partagée. S’il est implicite que le son doive faire entendre la parole dans la meilleure qualité, l’image peut prendre de la liberté et elle peut disposer de recul pour se poser la question comment regarder, comment faire apparaître le sujet. Cette liberté prise avec l’image semble relever d’une autorisation implicite de détachement au sujet parlant. Elle nous renvoie à une posture propre à l’art photographique. Apparaît ici un ordonnancement de distribution des tâches : si l’image est libre, c’est parce que le son est « contraint ».
Pour approcher un peu plus, il faut faire retour sur ce que nous avions désigné comme modèle de conception, sur la donnée qui nous est commune : les conditions de notre perception.
Comment écoute-t-on ? Car c’est en observant ce qui engage notre attention que l’on trouvera les outils efficaces à la production d’un désir d’écoute.
Lorsque l’on enregistre, on espère d’emblée que le micro va tout prendre, et que ce tout représente ce que l’on a entendu. Mais qui a entendu ? Est-ce que l’ensemble des sujets présents a entendu la même chose ? Cette écoute est-elle si indubitable ? A-t-on les bons outils pour saisir, comme on l’aurait souhaité, ce qui s’est produit ? Entendons par là, est-ce que les outils que l’on emploie à cette fin vont nous restituer l’objet attendu ?
Car la réécoute de l’enregistrement déçoit. Il nous restitue quelque chose d’étranger, dans une sorte d’écart à l’expérience vécue...
La raison en est simple. Lorsque je suis face au monde, je vais chercher les éléments que je désire écouter et mon rapport au monde est en permanence engagé dans un choix. Lorsque je suis plongé dans un espace sonore, je suis attentif à tout ce qui surgit autour de moi, pour être sûr que ces éléments ne sont pas dangereux, nuisibles à l’animal que je suis. S’il surgit un son qui est l’indice d’un danger, je me protège... Dans l’écoute, l’indice d’un danger l’emporte sur tout discours, c’est-à-dire qu’à l’écoute désirante l’emporte toujours l’écoute de protection… Que surgit-il devant moi ? Comme l’animal, je veille à mon territoire… Si je constate que tout danger est écarté, j’oublie l’incident et peux alors faire retour sur l’objet désiré. Si le bruit survenu attise ma curiosité, je vais l’écouter, mais cette liberté s’établit postérieurement à l’acte de protection.
De manière permanente, notre écoute se construit dans un cheminement désiré entre ce qui m’intéresse dans ce qui se situe autour de moi – c’est ça considérer le réel – et ce qui surgit et l’emporte, me débordant parfois (le niveau sonore est arrivé à un tel point que je ne peux plus écouter. Là est ma limite d’écoute…).
Ainsi la question du choix est rédhibitoire. Qu’a saisi le microphone ? Ce que j’ai entendu se retrouve noyé dans l’ambiance car le micro assemble dans le même temps, et dans leurs multiples niveaux de présence, tout ce qui émet alentour. Il n’a pas la faculté d’en discriminer les composants, alors que l’auditeur, au bout de peu de temps, a oublié la scène sonore qui l’entoure pour plonger dans le détail qu’il a choisi d’écouter. Mais si quand j’écoute l’enregistrement, je m’aperçois que ce que j’obtiens n’a rien à voir avec l’expérience que j’ai vécue, ce qui m’apparaît, et qui est bien pire, est que dans ce deuxième temps je ne peux plus faire de tri dans la scène enregistrée.
Voilà pourquoi il faut organiser les valeurs de présence de ce que l’on veut donner à entendre, il faut organiser un parcours de restitution pour l’auditeur, un « donné à entendre ». Et pour cela, il faut choisir et désigner dans la scène sonore, au fur et à mesure des surgissements et des évanouissements. C’est cela faire le son d’un film en direct.
Mais comment choisir ?
Vous connaissez tous les outils de captation, les micros cravate, les micros directionnels... Ils sont utilisés pour resserrer la zone de captation. Dans un plan large, offrant beaucoup de choses à voir et dans lequel l’œil circule, nous pouvons désigner, grâce à ces outils, des éléments. Si l’on peut resserrer l’espace par la largeur du cône de prise de son, pourtant tout ce qui existe au dos du micro s’inscrit aussi après réflexions sur les murs. Ce qui émet derrière le micro reste audible, même si son niveau est atténué. Aucun micro n’est capable d’isoler une zone sonore de l’espace. Ainsi, même avec un micro directionnel, je saisis l’ensemble de l’ambiance sonore de ce lieu révélant dans le même temps son acoustique. En conséquence, lorsque je prends un son, je détermine un rapport entre un élément sonnant et son espace environnant. Je ne peux donc pas penser prendre que des objets, je prends des rapports. Dans quel rapport vais-je prendre un élément ? Le plus important est la grosse voix bien timbrée en oubliant tout le reste, ou le reste est-il important et dans quel rapport à la voix ? Cela varie et je vais devoir choisir, décider sans cesse.
Mais comment choisir lors du tournage ?
Tout ne peut y être décidé, c’est sûr. C’est là que se justifie le renvoi à l’étape de postproduction. Dès lors, il est possible de considérer ce son comme un son témoin et tout refaire ; ou au contraire, nettoyer ce qui existe, retirer ce qu’on ne désire pas donner à entendre. D’où l’idée d' « un sonore : lieu de bricolage »… En effet, le bricolage est possible. Mais le bricolage établi a posteriori est effectué globalement sur la prise… Car si l’on peut toujours insérer des nouveaux sons, on ne peut pas extraire une ambiance derrière une conversation ou en modifier les niveaux.
Considérons le problème autrement. Le son des lieux, des espaces, ne désigne-t-il pas un supplément : la nature sociale des espaces… Si l’on ne désire entendre que le contenu des discours, il suffit d’utiliser la proximité des HF. Mais à la nature de l’objet saisi s’ajoute un point de vue placé en proximité à l’objet saisi. Il équivaut pour l’image à un plan serré. A-t-on envie d’écouter des plans serrés, des proximités, quelle que soit la taille du plan ?
Je vous ai présenté l’an dernier un extrait d’un film réalisé par Jean-Pierre Duret qui nous a intéressé par la méthode employée. Son expérience de la prise de son (chez Pialat, Dardenne, Des Pallières, Nicole Garcia, Agnès Jaoui, Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, etc.) lui a permis de prendre du recul sur la méthode et d’envisager des conditions de prises de vue différentes, en ce qui concerne ses propres réalisations. Il cadre son image secondairement à la mise en œuvre de sa prise de son. Au lieu de choisir préalablement un regard sur un personnage ou une situation et de bâtir ensuite une captation qui s’y soumet, il opère à l’inverse. Déterminant d’abord son point d’écoute, c’est en fonction de l’endroit d’où il souhaite écouter la scène qu’il va cadrer… « C’est à partir de l’écoute que je vais faire voir ». Il opère seul, prenant le son et l’image ensemble, avec une mini DV sur laquelle est fixé un couple stéréo. Il choisit un plan sonore, détermine une focale puis fait le point. Il décide de ce qu’il veut donner à voir, par rapport à ce qu’il donne à entendre. Nous avons là une attitude nouvelle : celle de penser un point de vue à partir d’un point d’écoute.
Pour revenir sur l’écoute.
Dire que le micro ne prend pas ce que l’on entend est fondamental. C’est ce à partir de quoi nous devons repenser le son. Cela implique une seule stratégie pour construire le son au cinéma : nous sommes contraints à reconstruire le réel, démonter pour reconstruire, rebâtir pour désigner. Comme le micro nous offre trop, nous devons mettre au point des stratégies de perte, pour perdre l’excès qu’il nous offre. Car, lorsque le son est pris il n’est plus possible à notre cerveau de séparer les constituants sonores rassemblés en surnombre sur l’enregistrement, nous avons perdu en pouvoir séparateur par rapport à ce que nous pouvons faire dans le réel. Organiser les sons d’un film serait tenter de déjouer la perte de pouvoir séparateur liée à la restitution de la prise de son par un système globalisant. Cela nous contraint donc à décider de sélectionner la méthode, voire d’inventer celle qui nous permettra le mieux de faire apparaître ce que l’on choisit de faire entendre.
À cet endroit nous sommes généralement loin d’être dans une situation idéale. Et face à ce qui représente la pratique dominante, que choisir :
- faut-il par un micro laisser entrer du son direct ? Il faut savoir que ce qui résulte de cette inscription se révèle soudain au public comme un objet donné, une forme en soi, et c’est la forme dominante que l’on confond à force d’usage, avec notre perception du réel.
- ou bien, faut-il reconstruire totalement le son ?
Décider qu’un micro va saisir l’ambiance du direct, c’est décider d’une forme d’écriture dominante, tout comme mettre un HF détermine un cadrage du son, sous un certain format, qui aura des répercussions sur la forme et la couleur sonore globale.
Si l’on définit un plan sonore, on détermine une manière d’écouter. Quelle est celle du HF ? À quel moment se trouve-t-on dans notre vie à cette distance de la voix ? Au moment où on est proche de la personne. On place ainsi la voix à l’endroit de l’intime voire de la confession. Ce qui est le plus incroyable c’est que dans les films de fiction, on entend souvent les gens s’insulter avec des voix de l’intime, même s’il y a une certaine intimité dans l’engueulade ! Ce que l’on découvre ici, c’est que les choix technologiques écrivent à l’endroit où les réalisateurs n’en n’ont guère conscience et où l’on croit en la technologie comme un absolu...
Les habitudes dominent, une sorte d’accord collectif de la représentation du sonore au cinéma, à force de réitération, devient la doxa : on croit que le son qui nous est ainsi offert est le son du réel, qu’il est ce que j’aurais entendu à cet endroit. « C’est la vérité puisque c’est ce que l’on a toujours entendu dans un film ». Et cette forme est devenue une convention de représentation du langage sonore, reconnue et acceptée par tous comme « le son du plan ». Pourtant si l’on écoute le son d’un plan en 1929, en 1970, et en 2007, on voit apparaître une évolution des formes et des valeurs de représentation.
Ce qui est essentiel de constater ici, c’est l’apparition d’une historicité du son au cinéma. Une histoire de l’enregistrement et de la représentation des voix, des sons et des musiques est apparue, même si elle n’est pas encore repérée et comprise comme telle. Si on veut considérer l’histoire des formes sonores, il faut parler des raisons qui en organisent le contenu.
Le contenu est aussi, et de toutes les façons, lié à la progression des technologies, à la naissance des nouveaux outils : l’arrivée soudaine d’un magnétophone portable permet d’entrer dans des espaces dans lesquels on n’enregistrait pas. Mais on va être soudain confronté à la question acoustique de ces espaces. On va mettre un certain nombre d’années pour choisir une solution, jusqu’à ce qu’arrivent les micros cravate qui permettent de se rapprocher sans placer de micro à vue dans le champ. Ne pouvant pas se limiter à des plans serrés, arrive la nécessité de cacher les micros pour pouvoir élargir le cadre.
Ainsi, le sonore du cinéma s’écrit en creux. Sans prétendre que personne n’en soit conscient, ce sonore se construit beaucoup par défaut ; faire du son au cinéma s’organise toujours dans une économie de sauvetage. Même sur un film de fiction où l’on a répété et eu le temps de placer ses micros, le sauvetage demeure.
Jouer du son
Finalement, faire du son au cinéma, c’est organiser les conditions de progression des événements dans le temps et dans l’espace. C’est aussi organiser la progression du mode d’existence des matériaux.
Nous devons tenter de conserver la conscience des détails de l’ensemble, discerner ce qui du direct revient à l’espace, aux acoustiques, à la distance, aux résiduelles, au bruit de fond ; mais aussi aux sons eux-mêmes, à leur nature, à leur plastique, puisque finalement tout son renvoie à une matérialité qui est liée à la nature de sa source. Si tout son provient d’un choc ou d’un frottement, il est issu d’un évènement en cours qui confronte des énergies et des masses dans des volumes. Il faudrait enfin s’apercevoir que chacun de ces éléments est une variable.
En conséquence, si je fais des sons pour un film, je ne peux pas simplement puiser des sons dans une sonothèque ; je vais devoir, comme pour le théâtre, choisir et enregistrer spécifiquement pour chaque événement le son que je souhaite y placer. Si je veux que cette scène soit sourde, je vais faire en sorte que ma vision du monde soit sourde au moment de ma prise de son. Je vais organiser « la surdité ». On ne peut se contenter d’une simple correction effectuée sur la console au moment du mixage. Je vais devoir alors penser et organiser un dispositif de captation sourde du monde. S’induit la question : comment jouer ces sons seuls ? Violemment ? Vont-ils arriver de loin ? Seront-ils déjà là ? Quelle est leur progression dans la durée ? Quelle est le mode d’existence de ce simple son ?
C’est à partir de cela que le cinéma travaille, dans ces petits endroits-là, dans ce presque rien. Parce que notre oreille est l’oreille de la captation du presque rien. Notre oreille travaille à cette échelle, celle de l’extrême nuance, c’est à cet endroit que se situe l’intelligence de l’écoute.
Ainsi, quand on enregistre une voix-off, il ne s’agit pas simplement de donner un texte et de le faire énoncer correctement. Entrer dans le sonore, c’est en décomposer finement les éléments, en découvrir les variables et les mettre savamment en jeu. Donner à entendre, c’est entrer en complicité avec l’autre à l’endroit de l’esprit voire du « mot d’esprit » sonore.
Il y a à cet endroit des décisions qui vont faire basculer un film. Ces décisions échappent souvent aux cinéastes. Pourtant, on ne peut pas dire qu’au cinéma ça ne travaille pas le son, au contraire, ça le travaille sacrément, mais le seul problème est que ça travaille toujours les mêmes variables. Combien de fois entend-t-on les cinéastes dire : « pour moi le son est essentiel ! ». Hélas, les réalisateurs délèguent, se disant qu’ « il y a un type du son qui sait faire mieux et qu’il faut prendre un super monteur son ». Ils doivent comprendre enfin que ce n’est pas suffisant, car le lieu de la création se trouve aussi et surtout à l’endroit du son. Et que si une avancée du cinéma s’opère, ce n’est pas du côté des outils, mais de l’écriture du son, dans ses qualités. C’est le réalisateur qui doit choisir, déterminer, c’est à lui de décider et pas en seconde main ; car il y a là des choix d’écriture, de forme, d’esthétique, des choix fondamentaux qui peuvent être de mille natures et qui agissent profondément, car le lieu du sonore est un lieu majeur du partage du sensible...
Coordination : Daniel Deshays, Julien Cloquet
Invités : Extrait du séminaire 2006 « Territoires du sonore », coordonné par Daniel Deshays. L’intégralité est publiée dans La Revue documentaire, été 2007.
Remerciements à Brice Cannavo et Tomas Matauko.