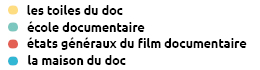2005
2005  Gian Vittorio Baldi
Gian Vittorio Baldi Gian Vittorio Baldi
De Seta, Baldi : dépasser le mur du son
Concurrencées sur le terrain du réel par les grandes fictions néoréalistes et malheureusement enfouies sous une pléthorique production de courts métrages, largement soutenue par l’État dans la seconde moitié des années cinquante mais sans souci de qualité, les filmographies sulfureuses et méconnues de Vittorio De Seta et de Gian Vittorio Baldi représentent la face cachée du réalisme italien, révélant un projet documentaire radical fortement teinté d’expérimentations visuelles et sonores. De 1954 à 1959, De Seta (né à Palerme en 1923) réalise en autodidacte dix courts métrages – dont Parabola d’oro, primé au Festival de Cannes en 1956 – marqués par un subtil équilibre entre élégance formelle et précision ethnographique.
De 1958 à 1961, Baldi (né à Bologne en 1930) en signe neuf – dont Il Pianto delle zitelle (1958) et La Casa delle tredici vedove (1960), tous deux Lions d’or du meilleur court métrage au Festival de Venise, mélange de rigueur descriptive et de cinéma de poésie. Certes, d’une œuvre à l’autre, on voit bien ce qui diffère, à commencer par les corps représentés : paysans, pêcheurs et montagnards chez le premier, homme du Sud, peuple de Rome et de Turin chez le second, cinéaste du Nord. Au rapport ingrat mais harmonieux qu’entretiennent encore avec leur environnement les villageois de De Seta répond la relation au monde à l’évidence plus douloureuse des personnages urbains de Baldi, davantage travaillés par les cicatrices du social et les blessures de l’Histoire. Cela n’empêche que leurs traits communs sautent aux yeux : un même désir de filmer la culture populaire, envisagée comme expérience intime, toujours reconstituée de l’intérieur, qu’il s’agit moins de capter que de rendre sensible ; un goût semblable pour un cinéma léger, conçu comme un artisanat solitaire et fait main ; une obsession identique de la couleur – Baldi allant jusqu’à délaver à l’eau la pellicule de Ritratto di Pina (1960), image par image, à la main, pour en atténuer les teintes et les rapprocher ainsi du noir et blanc. Mais c’est surtout en expérimentant tous deux les multiples possibilités du son direct que les deux hommes font figure de cinéastes avant-gardistes ou pionniers. Bruits du monde à partir du son original dans le cinéma presque sans dialogues de Vittorio De Seta, son synchrone et paroles incarnées dans les corps mêmes de ceux et celles qui les proclament du côté de Baldi (auteur, dès 1953, d’un manifeste en faveur du son direct) : dans les deux cas, il s’agit d’ouvrir le cinéma italien sur ce qui lui fait le plus cruellement défaut : une authentique culture du son. Ayant ainsi assuré la jonction entre le néoréalisme des origines – celui de la modernité rossellinienne, plutôt que celui de De Santis ou De Sica – et l’avènement des nouveaux cinémas dans les années soixante, De Seta d’abord, Baldi ensuite, pouvaient alors tenter l’expérience du long métrage – Banditi a Orgosolo (De Seta, 1961), Luciano – Una vita bruciata (Baldi, 1961) et Fuoco ! (Baldi, 1968), soit trois fictions du réel, venant baliser une décennie où, en Italie, filmer le peuple ne se faisait jamais sans désir de révolution.
Gian Vittorio Baldi
Formé au Centre national expérimental de cinématographie de Rome – où la série qu’il consacra à l’histoire récente de l’Italie lui valut une première reconnaissance, dès 1958 –, Gian Vittorio Baldi apparaît, dès ses premiers courts métrages, comme le grand cinéaste italien de la parole et du son. Son synchrone, parole en direct qui, pour lui, est littéralement ce qui fait événement ; parole libre, certes, mais pas nécessairement spontanée, recréée plutôt, rejouée face à la caméra en une forme renouvelée de l’a parte théâtral et transformée par la relation que le cinéaste développe toujours en amont avec ceux et celles qui sont pour lui davantage des présences devenues proches que des personnages documentaires. De là naît cette profonde empathie que ressent le spectateur de façon quasi tactile au moment d’entrer à l’intérieur de ces vies minuscules, saisies à la lisière de la loi, de la mort, de l’exil, dans un espace tranquillement devenu commun où chacun, filmeur, filmé et spectateur, peut avoir l’impression de faire corps avec la pellicule.
Par ailleurs producteur indépendant (Chroni-que d’Anna Magdalena Bach, Porcherie, Notes pour une Orestie africaine, Journal d’un schizophrène, Quatre Nuits d’un rêveur et les premiers films de Biette) et cofondateur d’une éphémère Internationale des Cinéastes Documen-taristes, Baldi réalise ensuite Luciano – Una vita bruciata, puis Fuoco !, longs métrages davantage tentés par la fiction. Délibérément conçu pour être inacceptable, sauf pour un spectateur de cinéma – parce que c’est à son expérience, non à son expertise, qu’il s’adresse –, Fuoco ! (1968), récit d’un carnage sans mobile apparent, donné à voir sans la moindre explication, met en scène une métaphore du pouvoir, une folie meurtrière née d’un pétage de plomb, renvoyant aux impasses d’une société qui aurait globalement perdu la raison. Tourné en quatorze jours, chronologiquement et, pourrait-on dire, d’un seul trait, en 16 mm et son direct, avec le moins d’interventions techniques possible, Fuoco ! est excessif, mais sa démesure est à la mesure de sa croyance dans le cinéma. Document sans concession sur la révolte envisagée comme dépense d’énergie et pur embrasement des corps, il met d’abord en jeu un corps de cinéma, chauffé à blanc par les raccords, rappelé à l’ordre par les mouvements de caméra, méthodiques, insistants, obsessionnels dans leur répétition. Ce faisant, c’est également le spectateur qu’il met en scène, bousculé dans ses habitudes, atteint personnellement, documenté sur son propre seuil de tolérance aux images, contraint de réfléchir à ce que regarder signifie. Car, contrairement à ce qu’on tente en vain de nous faire croire, regarder engage.
« Je voudrais aider le cinéma dans son agonie, je voudrais l’accélérer : il me semble qu’il n’y a rien d’autre à faire pour continuer d’avoir des idéaux, pour recommencer à tout reconstruire le plus tôt possible », écrivait Baldi en 1967, dans Rinascita. La suite cinématographique de ce projet ne m’est pas connue et nous la découvrirons ensemble à Lussas, une poignée de films restés invisibles en France, dont Nevrijeme – Il Temporale et Zen, qu’Adriano Apra, ancien directeur de la Cinémathèque de Rome, m’affirme être encore meilleurs, ou pires, selon les points de vue et les manières de voir. On pourrait dire, comme Fernand Deligny, selon les points de voir.
Invités : Avec la participation du Centre national expérimental de la cinématographie – Cinémathèque nationale de Rome